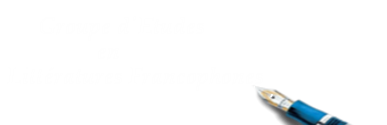IN MEMORIAM.
V. Y. MUDIMBE
Qui pourrait m’assurer que l’événement de la modernité accomplit, à coup sûr, le projet de la pierre de Marienkirche et le mystère de sa prise sur ‘une réalité’? Là, comme en cet exposé sur l’Afrique, la loi de l’écart. Me fait face autre chose : ce discours dans lequel des blessures d’aujourd’hui sont perçues à la lumière de nouveaux détours des droits sur une terre, ses confiscations et régulières répartitions. À l’arbitraire d’une expérience de la loi d’hier, nous faudrait-il remonter à celle d’avant-hier, et de là, régressivement, jusqu’à la genèse du processus vécu aujourd’hui, afin d’exorciser nos humeurs ?
V. Y. Mudimbe, Cheminements. Carnets de Berlin (Avril-Juin 1999)
Il ne laisse personne indifférent. On le célèbre ou on le rejette. Son œuvre, dont souvent on a entendu parler, sans l’avoir lue vraiment, suscite généralement le malaise du public lettré et même de la critique à porter jugement et valeur sur son auteur, comme le montrent les adjectifs utilisés pour le qualifier : « rebelle », « hermétique », « insaisissable », « érudit », « humaniste », « pluriel », « pluridimensionnel », « penseur pluridisciplinaire », « intellectuel foisonnant », « savant polyvalent », etc. On voulait, en effet, le définir, le classer, l’étiqueter, le fixer, le placer dans une cage, le prendre pour un sphynx de la mythologie grecque, c’est-à-dire une énigme permanente. Certes, il aimait rappeler ses origines modestes dont il avait tiré la conscience d’un double sentiment contradictoire de sa vulnérabilité (de l’être qui l’amenait à douter de lui-même) et la vigueur de sa pensée. Il faisait savoir (valoir) qu’il n’est pas « né fonctionnaire d’un savoir, ni porteur d’une vérité quelconque ».
Mais il a enseigné dans les plus prestigieuses universités américaines et avait tenu de nombreuses conférences dans les plus grandes universités des États-Unis, du Canada, d’Allemagne, de Grande-Bretagne, de France, de Belgique, du Portugal, des pays d’Amérique latine et centrale, etc. Certes, il a obtenu les prix prestigieux et de nombreux doctorats honoris causa. Mais il se pensait « en une transparence fragile (…) Ni meilleur ni pire, juste un homme, comme tous les autres. » Il se voulait néanmoins de partout et de nulle part. Toujours présent, mais toujours tourné vers un ailleurs. Certes, il usait d’une dialectique négative qui brise les alternatives et les binarismes fondateurs. Mais il ne rêvait pas de l’immortalité qui lui paraissait « indécente » à cause de sa prétention d’une « victoire incompréhensible sur la nature ». Il a pourtant produit une œuvre monumentale, distinguée, distinctive et d’une érudition exceptionnelle qui lui survivra. « Satisfait de (sa) vie, de « ses » actions, de (ses) insuffisances », il attendait son tour, pour retourner, « heureux », à la terre contribuer à la continuité de la nature.
Il, c’est V.Y. Mudimbe, cet autre dieu de l’Olympe, qui s’en est allé en toute discrétion, serein et en paix, ce lundi 21 avril 2025, en Caroline du Nord, aux États-Unis. « La mort, écrivait-il dans son autobiographie intellectuelle, Les corps glorieux des mots et des êtres, je l’ai toujours perçue comme un simple arrêt. Ni nuit, ni fin, encore moins une malédiction. On m’avait, très tôt, appris à ne pas la craindre. Memento, homo, quia pulvis es… (…) Et in pulvere reverteris, souviens-toi, homme, que tu es poussière, et que tu redeviendras poussière. » Il aimait à fréquenter les cimetières à la tombée de la nuit, et avoue qu’ils « conviennent, et excellemment, à une réflexion sur notre contingence comme êtres humains ».
Mudimbe mène une réflexion philosophique sur la mort à l’occasion de son cancer imaginé par des « médecins incompétents », écrit-il. Son fils aîné Daniel le rejoint, du Congo à Genève, puis, de Belgique, une filleule belge, Véronique Gallez. « Je pouvais, enfin, accepter mon destin et assumer mon sort. J’avais autour de moi, deux enfants, la joie de la liberté de demain, et le feu, comme mon désir de survivre, était là, dans les sourires venus de deux mondes différents. Mes ambitions s’annulaient, et le langage de la vie reprenait sens en l’existence de ces enfants ». Quelle générosité et quelle foi en l’avenir de la beauté de l’humanité. Les contingences sont ainsi transformées en espérance.
La méditation sur la mort traverse l’œuvre de Mudimbe. Il acceptait l’éternel mystère de la mort et avait appris à la domestiquer par un investissement excessif dans son travail intellectuel et ses méditations. En 1973, à 32 ans, Mudimbe est (le premier) doyen (noir) de la faculté de Philosophie et Lettres de l’université de Lubumbashi, élu par un corps académique majoritairement occidental, 120 professeurs dont 5 seulement étaient congolais. Un médecin de Lubumbashi lui diagnostique un cancer des os, que confirme un médecin dans une clinique privée de Genève où il est interné. Se sachant mort en sursis, et « pour nier cet obstacle », Mudimbe travaille, inlassable, simultanément, à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, à trois livres : L’autre face du royaume, un essai; Entretailles, un recueil de poème; Le bel immonde, un roman d’écriture avant-gardiste. Mudimbe refuse donc toute pose, et recherche aussi loin que possible la vérité. Comme si le surcroît de vie intellectuelle compensait ou annihilait la menace de la mort. Quand sonne le glas pour chacun de nous, il n’est pas certain de trouver l’énergie nécessaire pour accomplir cet exploit. Mais gravons dans notre mémoire la force que Mudimbe a exercée sur lui-même pour que le monde devienne plus beau et plus riche le sens.
C’était en 1973. Mudimbe pose le fondement des thématiques de son grand Texte : la réflexion sur le sens et la fonction des sciences sociales et humaines en Afrique, par des chercheurs africains; la philosophie africaine, le rapport de la littérature avec la représentation du réel; la question de l’Autre, auxquels il faudrait ajouter l’intérêt pour l’antiquité gréco-romaine. Encore étudiant à Lovanium, face à des discours idéologiques de recommencement absolu de l’histoire au lendemain des indépendances africaines, il souligne l’héritage occidental dont il invite à garder la mémoire. À l’époque, on ne parle pas de postcolonialisme ou de théories postcoloniales, on ne parle pas de décolonisation de savoirs ni de déconstruction ni d’Orientalisme, ni de Subaltern Studies, encore moins de décentrement (entendons que ce dernier terme signifie tout simplement un déplacement du centre d’un lieu à un autre – on a même dit « provincialiser l’Europe » – ce qui est remplacer un fondamentalisme par un autre) et de décolonial (qui, en déconstruisant l’eurocentrisme, examine notamment le conditionnement du complexe d’infériorité des ressortissants des anciennes colonies et aborde une approche intersectionnelle des luttes). Paul Valéry avait, au lendemain de la première Guerre mondiale, constaté la fragilité et l’effondrement de la suprématie occidentale: « Nous autres, civilisations, nous savons que nous sommes mortelles ».
Au mot d’ordre marxien, il faut changer le monde, les chercheurs du Sud global, comme on dit aujourd’hui, réagissent par son pendant qu’il faut changer le langage, (donnant au discours une puissance performative que la réalité dément), ce qui était déjà la profession de foi de Stéphane Mallarmé, comme si la révolution du langage conduisait à une transformation du monde ou à utiliser en notre faveur la mémoire de l’horreur du passé, en nous identifiant aux victimes innocentes. Nous nous parons aujourd’hui de tous ces nouveaux biens symboliques pour l’orgueil et la gloire de notre posture vis-à-vis de nos objets de recherche. Nous pensons ainsi retrouver dans le présent notre fierté personnelle, et compenser l’humiliation de la défaite que l’histoire nous a fait subir naguère, par une victoire rhétorique, à travers la surenchère en quelque sorte hystérique de l’invention des concepts, des notions et des termes dans les domaines de nos disciplines scientifiques que nous manipulons avec assurance et témérité. Quelle autodérision! Même Karl Marx, qui rêvait de la dictature du lumpen prolétariat, reconnaissait, impuissant, que ce ne sont pas les idées qui changent le monde, mais les rapports de production. La sociologie institutionnelle permet de comprendre l’aveu insistant de rupture avec le modèle dominant. « On ne peut se poser qu’en s’opposant », écrivait Pierre Bourdieu. C’est là une stratégie bien rôdée des nouveaux « entrants » qui se battent pour faire émerger leur parole et conquérir le pouvoir des dominants en renversant la théorie (ou pratique) en vogue, tout en étant fascinés, encombrés et entravés par le modèle qu’ils abhorrent et qu’ils veulent évincer. L’accent politique lui confère toute sa portée. Qu’importe! Cette stratégie itérative d’inversion de positions traduit notre désir mimétique et le désaveu de notre capacité à prendre la place des dominants.
Mais, en ce temps-là, au début des années 1970, on ne parle pas encore non plus de la diversité ni de l’altérité, ou pas autant et beaucoup moins qu’aujourd’hui, malgré les avancées timides et contradictoires des poètes de la négritude, Aimé Césaire et surtout Léopold Sédar Senghor. Le bel immonde inspire au roman africain des nouvelles techniques d’écriture et introduit la question du « genre » dans toute sa complexité en campant un puissant personnage féminin, étudiante en médecine à l’université de Kinshasa, devenue par le hasard des circonstances une femme de joie, à la fois hétérosexuelle et lesbienne. Celle-ci demeure un maillon de sa tribu qui est en rébellion contre le gouvernement central. Ainsi s’opère de façon violente et savoureuse l’intrusion de l’altérité dans une œuvre qui se veut une célébration de l’ipséité.
Ces réflexions initiées en 1973 qui vont absorber Mudimbe toute sa vie font aujourd’hui la part belle des découvertes et le bonheur des mises en scène devenues routinières d’une pratique scientifique ritualisée indissociable des avantages liés à l’occupation d’une position sociale. Mudimbe faisait pourtant surgir là une manière neuve, distinguée et distinctive de concevoir la libération du discours africain, de l’Afrique, ainsi que le rôle et la responsabilité des chercheurs africains. Curieux insatiable de tout, il cultive la différence et l’éthique de la désappartenance. Il se veut « écart, esseulement, isolement », dans les marges. D’où sa devise : « Etiam Omnes, Ego non », expression de sa solitude et de son indépendance d’esprit, de l’intellectuel écoutant sa seule conscience, orgueilleux et fier de l’être, s’imposant, contre les clans et les chapelles, la pensée figée et les compromissions, des devoirs plus lourds qu’aux autres.
Elisabeth Mudimbe-Boyi, son épouse, veillait, discrète, forte, lucide, prévoyante. Mudimbe lui a dédié son autobiographie intellectuelle » : « Pour Elisabeth Boyi, Etenim apud te es fons vitae, et in lumine tuo video lumen ». Il avoue : « Voilà que je rencontrais une jeune femme africaine intelligente, rationnelle et, à tous égards, mieux en prise sur le monde que je ne l’étais (…) Elisabeth s’intégra dans ma vie comme exorcisme (…) Universitaire de carrière (…) elle a, toujours, eu autre chose à faire ». Il s’ensuivait entre eux de longues heures d’échange sur divers sujets de leurs recherches.
Elisabeth Mudimbe-Boyi, analysant, perspicace, la situation du Zaïre, suggéra à V.Y. Mudimbe de solliciter une bourse Fulbright. Leur ami David Gould avait trouvé pour elle un remplacement d’un an à l’université de Pittsburgh où il enseignait. Deux semaines après leur départ, Mudimbe est nommé membre du Comité central du MPR, organe suprême du parti-État. D’une intégrité morale absolue, il ne répondit même pas à l’offre, refusant les éblouissements et les illusions de la politique congolaise. Il ne cherchait pas l’argent, il ne cherchait pas la gloire ni les honneurs. Il était authentique avec lui-même dans l’engagement à ses idées, alors que ses collègues se (dé)battaient pour être cooptés membres des organes du parti. Comme aujourd’hui, plus qu’hier, l’armée d’universitaires, devenus cerbères des régimes, engagés dans des compromis douteux et relayés aussitôt par des médias et les réseaux sociaux omniprésents, s’obstinent à trouver des justifications rationnelles aux choix du pouvoir, même à sa violence illégitime, soit au nom de l’État de droit, soit de l’ordre public, soit d’une révolution de la modernité ou d’une vision jamais définies.
L’Afrique (dans sa diversité, sa pluralité et sa multiplicité) demeure le centre de gravitation de l’œuvre de V.Y. Mudimbe – œuvre davantage enjeu qu’objet de lectures -, qu’il s’agisse des textes littéraires, des essais, d’autres publications savantes. Sa production américaine (The invention of Africa, The Idea of Africa, Parables and Fables, Tales of Faith, On African Fault Lines, etc.), reprenant à maintes reprises le même objet, creuse le même sillon, dans un mouvement en spirale. Comme si, voyant le mal se propager, Mudimbe voudrait aviser que l’histoire se répète, et qu’il était salutaire de rappeler sans cesse le passé, pour éviter l’horreur ancienne. Mais l’Afrique dont il déplore l’échec des dirigeants et de son intelligentsia n’est pensable, pour lui, qu’en relation avec son histoire, balançant ainsi son érudition entre la nécessité et la contingence. Aussi avoue-t-il, dialecticien et éclectique, incarner les deux mémoires, africaines, les anciennes, et la coloniale, les cultures africaine et européenne, comme on pouvait déjà le lire dès les titres de ses premiers essais, L’autre face du royaume et L’odeur du père.
Cette volonté du dialogue de cultures, Mudimbe l’exprime notamment dans sa réflexion sur le christianisme qu’il veut rendre fidèle au message évangélique, lui donner un visage humain, celui de la foi (faith), de la tolérance et de l’amour envers l’homme. Ses romans Entre les eaux ou Shaba deux montrent, à travers leur itinéraire, la quête de Pierre Landu et de Marie-Gertrude, celle de la grâce, de la liberté, du bonheur de l’humanité, d’un monde plus juste et plus équitable. L’Écart se termine par un rituel kuba dans lequel Nara fond Aminata et Isabelle.
Cette Afrique dont rêve Mudimbe doit accepter et assumer son histoire, en tirer des leçons pour sa modernité, dans une attitude de critique permanente des traditions, des discours et des pratiques, en dialogue constant avec d’autres cultures et civilisations. La maîtrise des langues étrangères (grec, latin, italien, néerlandais, allemand, anglais, français, espagnol, portugais, hébreu, etc.) par Mudimbe symbolise cette soif de communier avec les cultures et d’établir des ponts entre les civilisations. Sa mouvance géographique – qu’il appelle nomadisme – qui traduit l’excentrement de sa parole en témoigne : Congo, Rwanda, Cameroun, Kenya, Sénégal, Gabon, Congo (Brazzaville), France, Belgique, Angleterre, Pays-Bas, Allemagne, États-Unis d’Amérique, Canada, pays d’Amérique latine, etc. Pour Mudimbe, l’avenir de l’Afrique est, malgré l’horreur de son passé, entre ses mains, et les spécialistes des sciences sociales ont un rôle à jouer et une responsabilité à assumer.
S’affirme dans cette position toute une vision de la recherche scientifique en sciences humaines et sociales en Afrique, qui doit être en adéquation avec la réalité sociale. D’une part, Mudimbe postule, peut-être sans le savoir ou, du moins, sans jamais le dire, l’unité de la recherche et de la morale. La morale implique les catégories de la volonté, de la liberté et de la responsabilité. Mudimbe exprime, ce faisant, non ce qui est, mais un idéal de ce qui devrait être. Il indique sans détour l’attitude du sujet africain, personne vivante, chercheur, créateur. D’autre part, il pose l’unité de la recherche scientifique et de la vie, dans l’idée de responsabilité (ce qui est aussi de culpabilité).
Le chercheur africain en sciences sociales et humaines doit lier son travail scientifique à sa vie, assumer sa production, ainsi que tous les autres actes dans son existence. Autrement dit, V.Y. Mudimbe laisse entendre que la connaissance du monde ou de l’esprit du temps (Zeitgeist) est insuffisante. Il importe au chercheur, devenu sujet, de décider d’assumer par un acte de volonté, simultanément et solidairement, sa recherche (qui doit représenter le monde réel environnant) et sa vie quotidienne (et ses contingences). Comme on le remarque, la science est non seulement un produit, mais aussi un acte, c’est-à-dire un événement.
Devenu agnostique, comme il le dit, sur le plan philosophique, côté cour, Mudimbe est resté profondément catholique, côté jardin. Il continuait de réciter son bréviaire comme du temps qu’il était moine. Il continuait de psalmodier en latin pendant son travail le chant grégorien dont il a partagé le charme avec mes étudiants de doctorat de l’université Laval à qui il envoyait des CD (de chants grégoriens) et de très belles cartes. Il continuait de bénir des personnes qui le lui demandaient à l’occasion des rencontres fortuites dans des espaces publics. Il observait lui-même que sa coupe de cheveux était restée bénédictine. Il a même repris occasionnellement le Frère Mathieu, son assignation statutaire de moine. Comme un signe de fidélité au père, le nom du père destiné à couvrir simultanément l’acte et son sujet.
Il serait, en effet, aisé de montrer les procédés de catholicisation du sens chez Mudimbe, dont la citation, la description symbolique des tableaux des peintres célèbres, l’usage particulier de la métaphore et du symbole, le lexique abstrait, d’indétermination, les points d’interrogation et de suspension qui laissent planer le mystère, la transformation d’une destinée singulière en un destin collectif, tout cela irradie l’histoire et lui confère l’indice d’une généralisation et d’universalisation.
Il projetait d’écrire un Traité sur l’Eucharistie. Profondément catholique, Mudimbe a aménagé une paroisse à côté de son bureau dans la maison familiale, où il recevait régulièrement les anonymes, femmes et hommes simples, les laissés-pour-compte, qu’il appelait joyeusement ses « paroissiens », rebuts de la société capitaliste, ceux qui luttent ils ne savent contre quoi qui figure le dénuement. Il maintenait ainsi un contact avec le monde commun. Et, quelle coïncidence, relevait Bogumil Jewsiewicki, susceptible de nourrir toute une mythologie, il est parti au lendemain de Pâques, jour de la résurrection, comme le pape François, et enterré le même jour que le pape. Philosophe, il s’interrogeait : « La mort, comme défaite provisoire, est-elle le prix à payer pour refleurir ? »
Mudimbe s’attache à réfléchir à des thèmes les plus variés qui vont des événements liés à l’histoire (esclavage, traité de Berlin, nazisme, fascisme, communisme, État, nation, nationalismes européens, capitalisme et division du travail, colonisation, dictatures africaines, libéralisme, Hiroshima et Nagasaki, etc.) aux portraits des autres auteurs, peintres, voyageurs, musiciens, sociologues, écrivains, historiens, philosophes, médecins, psychiatres, psychanalystes, théologiens, religieux, etc.) sur lesquels il porte un éclairage, scrutant l’homme qui s’y cache. Occasion, pour lui, d’évaluer leur pensée et d’esquisser en creux son propre autoportrait dont on peut dégager son cosmopolitisme, sa boulimie de connaissances et sa « volonté d’apprendre des choses singulières », selon le mot de Leibniz.
Il est frappant, d’ailleurs, que Mudimbe ne raconte pas l’histoire de ces événements, sous la forme d’une saga avec ses péripéties et ses multiples rebondissements. Il s’attache plutôt à mener une réflexion, longue et patiente, qui finit par rejoindre l’histoire comme un horizon d’attente, de manière incidente, fragmentaire, latérale, sous la pioche de l’archéologue, à travers des traces (figures, paysages, sites, acteurs divers, petits faits, mots, etc.) Mudimbe est davantage intéressé à décrire les mutations qui accompagnent les bouleversements historiques. Par-devers l’Afrique, il s’efforce de comprendre les passions, les conduites et les comportements humains, les actes sociaux, les régimes politiques africains et leur orientation socio-économique, les idéaux, une spiritualité, un cosmos. Il veut saisir le sens du passé pour nous aujourd’hui. Mudimbe lègue une précieuse leçon à partir de son attitude vis-à-vis du passé, celle d’un humanisme qui consiste à garder des positions modérées même sur le mal subi. Quelle que soit la folie du monde, seule la raison doit guider nos actes.
D’une méditation à l’autre, Mudimbe insiste fermement sur notre commune humanité, qui que nous soyons, victime ou bourreau, faible ou puissant, malgré nos convictions et nos actes. Peut se lire dans cette approche la force de Mudimbe, cette capacité à distinguer et à séparer le bien et le mal, tout en ne perdant pas de vue toutes les nuances dans chaque entité. Il réussit ainsi à maintenir un équilibre difficile : ni nihilisme ni manichéisme. S’il assume des jugements de valeur, il fait tout pour éviter de se poser en moraliste péremptoire. Dans ses réflexions, Mudimbe n’idéalise pas les victimes ni ne noircit les bourreaux, mais il est loin de confondre les uns avec les autres. Il plaide pour la rigueur et la complexité de l’analyse, au lieu de se contenter de réponses et des généralisations faciles. Il faut examiner scrupuleusement les cas, même chez les coloniaux.
Mudimbe médite sur l’exil, les diaspora, les minorités, les identités culturelles, la rencontre de cultures, la race, la cause de la femme, l’exclusion sociale, la peinture urbaine (« l’art populaire »). Il plonge intrépide sa réflexion philosophique dans la magie et le surnaturel du quotidien tragique et banalisé, afin de tirer l’inédit du commun et de saisir les mystères dans la vie de tous les jours. Il y observe des tranches de vie. Il essaie de comprendre la poésie nimbant le chaos de la prose du quotidien. Le poète se mue en philosophe et en anthropologue. Il analyse, à travers le prisme de la conscience d’un sujet singulier, de petites péripéties de la socialité et ces solitudes parallèles que traduit l’échange quotidien, révélant tout un univers social. Il en dégage l’efflorescence de l’anodin et la profondeur de l’instantané. Ces tropismes excitent sa réflexion, lui offrant l’occasion d’aller du particulier au général. Si sa plongée dans ces sphères marginales lui permet de renverser la culture officielle, ses réflexions sur la « culture populaire » sont un moyen pour lui de se situer et de protester contre le monolithisme de la culture officielle et son dogmatisme. C’est Réflexions sur la vie quotidienne. C’est Autour de la nation. C’est Déchirures. Ses Carnets. Ainsi, la distinction de son œuvre par la catégorie des genres – expression de nos propres limites – hiérarchisant, en les cloisonnant, les plans de signification (le Mudimbe de la réflexion des essais, le Mudimbe de la fiction et de la poésie, le Mudimbe des Carnets, le Mudimbe des autres publications savantes, etc.) nuit à la profondeur et à la cohérence de la pensée.
Il y a de la fiction, de l’ironie et de la poésie dans les essais. Comme la méditation et la poésie parcourent ses romans. De même, les recueils de poèmes et les carnets sont traversés de réflexions et de fiction. Toutes ses idées se tiennent, même s’il ne peut pas les exprimer toutes en même temps. Chaque méditation constitue une pierre servant à l’édification de sa cathédrale. Mais, d’un ouvrage à l’autre, la pierre se nourrit en s’enrichissant de la maîtrise des savoirs accumulés et de la connaissance de l’objet antérieure, établissant les relations de complicité parfois conflictuelle à travers l’oxymore. On peut signaler des relations possibles et des corrélations fonctionnelles d’un texte avec lui-même ou avec les autres, en pensant à des réduplications internes ou qui dédoublent les réflexions, sans donner l’impression de redondance, la reprise des axes thématiques (ou des mises en abyme) à une autre échelle. L’œuvre est encyclopédique, érudite, à l’image de son auteur qui, pour un séjour de 7 jours à Québec, voyageait avec deux valises de livres à lire, et s’enfermait dans sa chambre d’hôtel pendant même trois jours, se nourrissant de raisins secs.
Dans cette perspective, l’œuvre de V.Y. Mudimbe traduit la conscience humaine dans son individualité affirmée et son universalisme à la fois. Mudimbe connaît mieux que d’autres les faiblesses de la condition humaine, sa misère interminable, au sens pascalien, mais aussi la force vitale, la grandeur implacable, qui peut en sortir. Né en 1941, le jour de l’Immaculée conception, alors que les travailleurs de la Gécamines déclenchaient une grève pour revendiquer de meilleures conditions de travail, Mudimbe a connu la boue et l’or. Il a vécu les renversements, les transformations, les tumultes : l’épopée coloniale ainsi que l’éclat de ses feux d’artifice et l’ombre épaisse qui l’enveloppe, les immenses espoirs des indépendances africaines, les guerres d’après indépendance, les affres des conflits interethniques au Rwanda où il a été moine à Gihindamuyaga, l’implication de l’Église catholique dans ce ravage, les rébellions mulélistes, les éclairs de l’université Lovanium, les tribulations du parti-état et les mirages de l’authenticité zaïroise, l’exaltation suscitée par le marxisme, mai 68 et la libération des mœurs, l’effervescence des mouvements d’émancipation des années 70, la guerre froide, la chute du mur de Berlin et l’effondrement de l’URSS. Il a vu le désordre, l’incertain, l’inconcevable, l’inexplicable, l’indicible social, le complexe. Il a observé la barbarie, la capacité terrible de l’humanité à s’autodétruire.
Dans son œuvre, Mudimbe témoigne de la magie de l’interdisciplinarité pour une meilleure connaissance du monde et de l’homme, de la société et de son fonctionnement. Aux prises avec la richesse (la diversité) du monde et la complexité humaine, Mudimbe ne se contente pas de connaître ce monde. Il pense et médite pour le comprendre. Façon de dire sans dire que le maître a perdu le privilège de voir sans être vu, et de nous aviser qu’il faut savoir se servir à perfection de son arme miraculeuse, celle du discours, et la lui renvoyer à travers un miroir, pour qu’il contemple sa propre image, celle de Narcisse. Pour Mudimbe, il convient de dépasser les connaissances particulières de chaque discipline, pour établir un lien entre elles, ce qu’on appelle la science. En 2012, l’université Laval lui décernait un doctorat honoris causa. La profondeur de son mot de circonstance sur l’interculturel résonne encore.
Relevons, en passant, qu’une certaine lecture convenue et fermée de V. Y. Mudimbe ne retient de l’œuvre que cet aspect de sa « reprise » à nouveaux frais notamment de Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Claude Lévi-Strauss, Pierre Bourdieu, Paul Ricoeur, Emmanuel Lévinas, Jacques Lacan, Michel de Certeau, George Canguilhem. On accorde ainsi crédit à la fétichisation des influences qui renvoient Mudimbe à toute une tradition française. On s’ingénie même à trouver des sources imaginaires, allant jusqu’à « penser » l’impensable, croyant à la toute-puissance du signifiant, à savoir que le titre L’invention de l’Afrique s’inspire de celui de Michel de Certeau, L’Invention du quotidien, oubliant, pour l’anéantir, l’originalité du dernier usage, comme si le signifiant était détaché de ses signifiés, transformant de fait le signifié en signifiant par la magie de la connotation, ignorant que le cotexte (environnement verbal) n’est pas le même et que le signifiant « invention » n’a pas le même signifié, de De Certeau à Mudimbe. Entendons que le langage est « l’avènement d’un événement », le surgissement de ce qui n’a jamais existé auparavant et qui accomplit une nouvelle configuration entre les énoncés et leurs énonciateurs. L’hypothèse offre au moins l’avantage de penser l’impensé qui la rend pensable, et d’interroger l’inconscient et ses présupposés inhérents à l’histoire.
Ramenant l’inconnu au déjà connu, on réduit les auteurs africains (re)connus à faire la gnose, telle que l’entendent les censeurs, et à n’être que des lecteurs qui glosent sur d’autres auteurs français (re)connus. Variation scientifique du « Nihil novi sub sole » (« Rien de nouveau sous le soleil ») quand on entre dans le champ scientifique africain. Façon de reprendre la dénivellation des discours à travers la dichotomie de la raison scolastique entre les lectores, ceux qui pratiquent le commentaire et sur qui on historicise le savoir, et les auctores, ceux qui sont à eux-mêmes leur propre fondement, leur propre commencement, et pour qui on n’a pas besoin de chercher le mythe fondateur, la genèse ou la pureté des origines. S’appuyant sur la philologie, et donc se livrant à une enquête historique minutieuse, Mudimbe montre que le lector peut se penser et être un véritable auctor qui se donne pour mission d’élucider et de « dé-voiler » à l’origine et à son commencement la « vérité de l’Être » – dans la théorie de Heidegger, la « vérité » est un « dé-voilement » – inscrite dans une histoire, longtemps oubliée et refoulée.
Mais les digues protectrices sont en train de céder. Lecteurs et critiques jouissent de plus de liberté et de discernement, afin de rendre raison au sens. La critique des sources (et non intertextuelle) pose le problème de la production scientifique. Il n’existe aucune instance de création littéraire ni de production scientifique sans lien avec le discours ou la découverte antérieurs, avec les cultures, avec le moment, avec les conditions de production de la découverte. L’inspiration de la muse est une hallucination et une illusion. Au mieux, la critique des sources prouve l’érudition et ne peut mettre à jour que des archétypes d’un passé. De Paul Claudel, à propos de sa poésie, Cinq grandes odes : « Les mots que j’emploie, Ce sont les mots de tous les jours. Et ce ne sont point les mêmes! ».
Signalons, pour illustration, que Jean-Paul Sartre emprunte à Hegel les concepts d’« en-soi » (an sich) et de « pour-soi » (fûr sich), mais leur attribue une signification nouvelle. De Husserl dont il a suivi les cours à Berlin, il a retenu que « la conscience est toujours conscience de quelque chose » dans la construction de sa philosophie de la liberté. La relation langage et pouvoir, Michel Foucault la tire de Nietzsche, selon Habermas. Jean-Paul Sartre et Albert Camus se sont nourris de Husserl et de Heidegger dans la théorisation de l’existentialisme et de l’absurde. Jacques Lacan s’est abreuvé auprès de Sigmund Freud.
Jusqu’où, en effet, reculer les limites de cette critique d’érudition ou d’humeur ou de goût, c’est selon, quand on cherche à parcourir le chemin qui éloigne de l’œuvre présente? Infiniment, jusqu’à Aristote ou à Platon et à Socrate, c’est-à-dire au « miracle gréco-romain » – l’Un – auquel renvoie Cornélius Castoriadis qui le considère, dans une vision fondamentaliste, comme la source de la pensée et de l’histoire ? Mais jusqu’où s’étendait ce monde grec et romain dont Mudimbe tirait les leçons de sagesse, de philosophie, d’humanisme et de diversité ? D’où venaient ceux qui l’animaient? Cheikh Anta Diop, dans un autre fondamentalisme, célébrait l’antériorité des civilisations nègres. En retrait, tacticien, entre les deux voies, Mudimbe nuançait que les autres civilisations avaient, bien avant la rencontre avec l’Occident, leurs manières de vivre ainsi que leur système de pensée par lequel elles lisaient, analysaient, scrutaient et construisaient le monde. Usant du même sens de nuances, il renvoyait dos à dos, mais avec élégance, afrocentrisme et eurocentrisme.
Chaque société secrète des stéréotypes qui se fondent sur des discours antérieurs à partir desquels se construit tout discours. Investir la science, se lancer dans la recherche ou créer, c’est inscrire sa pratique dans un environnement peuplé d’une multiplicité d’autres discours ou d’autres découvertes dont on se démarque par une double stratégie de différenciation et de distinction. Ce qui est une manière de (ré)concilier l’Afrique et l’Occident. Dans cet ordre d’idées, le concept de « bibliothèque coloniale » prend tout son sens et son importance. S’il est tentant de situer celle-ci dans les limbes coloniales, c’est, au demeurant, à partir du XVe siècle que se développe en Occident une production scientifique dans tous les genres (essais, littérature, médecine, psychiatrie, etc.) qui prend pour objet de recherche l’Africain (ou l’Afrique) représenté notamment comme primitif, dégénéré, malade, fou, endormi, en transe, à qui on dénie la raison, c’est-à-dire son humanité. Le savant pensait son objet en le néantisant, reconnaissant ainsi l’irréductibilité de l’autre en (dé)niant son existence. Jean-Pierre Dozon avait bien analysé le paradoxe de cette posture occidentale à l’égard de l’Africain dans Frères et sujets. La France et l’Afrique en perspective, signifiant que l’Africain ne peut être considéré comme frère que s’il accepte d’être asservi. « La bibliothèque coloniale » se présente donc comme une geste (qui détemporalise) située in illo tempore, hors-temps, « hors chronologie ».
Gaston Bachelard rappelait avec justesse que « le monde où l’on pense n’est pas le monde où l’on vit », voulant souligner la nécessité de la frontière entre les deux mondes. Manière de dire que la connaissance transcendantale doit s’appuyer sur la connaissance pratique ou empirique, et que le sujet réfléchissant ne doit pas remplacer l’agent agissant ni lui faire porter à la conscience ses représentations personnelles, afin de ne pas altérer la quintessence de l’expérience (vécue). La bibliothèque coloniale invite à tirer une leçon du passé qui en appelle à l’approfondissement d’une prise de conscience et à sa poursuite en toute indépendance. Elle offre à son auteur un point d’orgue, et faisant signe vers une profondeur insondable, elle est occasion et acte d’émancipation. Sorte de mise en abyme, « histoire dans l’histoire », « œuvre dans l’œuvre », en tant que réflexive, mais anachronie, projetée dans l’orbite de l’allégorie, elle est une histoire qui se développe sous couvert d’un symbole donnant à penser et à traduire la portée de l’histoire par un signifié inépuisable, embrayant les isotopies l’une après l’autre.
Ce microcosme de l’histoire se surimpose au macrocosme qui l’inclut, le déborde mais finit par l’envelopper à son tour. L’histoire subit ainsi une dilatation sémantique et acquiert le pouvoir de produire du sens, de façon à en assurer une pluralisation. La bibliothèque coloniale fonctionne dès lors comme une sorte de parabole ou, mieux, comme une métaphore vive des mécanismes de domination qui structurent et façonnent encore les rapports entre « l’Un et ses autres », et dans le cadre desquels le dominant, tout-puissant, a toujours raison, parce qu’il a tort. D’où la volonté d’a-temporalité et de flou historique qui sert à élargir le cadre à toute domination, mais aussi à toute résistance, passée et présente. Elle peut ainsi inférer et référer à toutes les stratégies par lesquelles on disqualifie et déshumanise l’autre pour l’assujettir, pour des raisons que la raison ignore.
Ce qui caractérise Mudimbe, c’est le sens critique exercé aussi bien sur « la bibliothèque coloniale » – dont les effets pèsent encore sur les rapports entre l’Afrique et l’Occident – que sur les traditions, les cultures et les croyances africaines. Poussant la réflexivité à ses limites, Mudimbe se demande le lieu archéologique – la notion de « Reprendre » revient souvent dans ses méditations (même dans son dernier essai On African Fault Lines) – de sa propre parole, prolongeant, développant et approfondissant la réflexion qu’il avait initiée dans L’Odeur du Père.
Mudimbe reconnaît que sa parole est située, aux prises avec les contraintes des déterminations sociales et de divers héritages parfois contradictoires. Elle prend place au sein d’autres « formations discursives » (Foucault) antérieures ou contemporaines qui la rendent reconnaissable et qui l’instituent comme discours en lui assurant sa légitimité. Son langage comme son discours est un déjà-là et un déjà-vu de sa représentation. La préhistoire de sa singularité (de sa subjectivité) donne à sa prise de parole le pouvoir de juger, jauger, vivifier la vérité des énoncés et des évidences repris dans un champ qu’il dénonce et dont il veut pourtant prendre des distances. Ce qui importe, en effet, c’est moins la façon méthodique et rigoureuse dont il déconstruit et démonte l’ordonnancement des traces des discours antérieurs ou contemporains que la puissance véritable d’organisation et de construction de son propre discours, métaphore et métonymie d’une nouvelle ère.
Dans ses Carnets comme dans son autobiographie intellectuelle, sorte de testament spirituel, le personnage de Mudimbe demeure central. Après avoir gardé le silence pendant longtemps sur son individualité, en dépit de l’introspection de ses personnages romanesques, il se place au centre de sa quête et il dresse progressivement, quoique de façon fragmentaire et lacunaire, son portrait intellectuel. Adoptant le parti pris d’une représentation subjective du monde, guettée par moments par l’illusion, s’hypostasiant comme personnage au destin unique, fruit d’une « élection », Mudimbe se pose comme le sujet de la volonté mais aussi comme le sujet qui contemple et se replie dans une solitude (pro-créatrice) qu’il dénonce tout en renouant une relation avec son passé. L’écriture lui permet de dépasser l’itération de cet « avant » à travers le dédoublement du sujet qui se transforme en objet de contemplation et s’objective tel qu’il se confronte à l’acharnement têtu du vouloir-vivre. Écrivain, il est aussi esthète. Désabusé, il analyse ses propres comportements, volitions ou élans, observe la vanité des choses et ironise sur la seule vérité de son moi. Ses carnets et son autobiographie entremêlent habilement deux axes thématiques. Mudimbe y évoque, d’une part, les grands événements de l’histoire de l’Afrique et de l’Europe (et des États-Unis) des XXe et XXIe siècles – à savoir la colonisation et la réduction à l’esclavage par les États européens des millions d’êtres humains noirs – à travers les portraits nuancés de nombre de leurs acteurs. Il y insère des péripéties constitutives de sa propre existence, essentiellement scientifique. Il y effleure à peine le versant familial (Parables and Fables; Les corps glorieux des mots et des êtres ; Cheminements).
D’autre part, il y condense l’ensemble de ses écrits. Il résume en quelques pages denses l’argument central de chacun. Il y ajoute la réception critique ainsi que son métatexte, ses propres commentaires rétrospectifs qui piègent le lecteur en lui dictant sa propre critique. D’une certaine manière, ces ouvrages absorbent l’ensemble d’une vie et d’une œuvre. Ayant pensé sa vie, il voulait aussi vivre sa pensée, pour éviter la rupture entre la vie et la pensée. Soucieux de dire la volonté de son être, il a réussi à sculpter son existence comme une œuvre. Il est un être singulier dont le destin par lui-même interprété, se transforme en destin collectif. En cela, il est un individu universel.
La réflexivité et l’auto-réflexivité constituent, pour Mudimbe, une stratégie dans la démarche de la lutte scientifique (et de sa violence symbolique) qui se dégage de la bibliothèque coloniale. « Reprendre » la généalogie et l’archéologie de celle-ci, c’est admettre et poser son historicité et, donc, l’historiciser. C’est nier, de ce fait, de la fonder par l’analyse qu’il en fait, en postulant que la bibliothèque coloniale a été créée, contre toute raison, par l’histoire dans un ordre dominé par l’arrogante raison des dominants pour des raisons de fonctionnalisme et d’utilitarisme. De même qu’il reconnaît à la science (ius sciendi) la légitimité, de même Mudimbe met en garde néanmoins contre son impérialisme (ius dominandi). D’où une fois de plus la nécessité de l’exigence de la morale qui est seule hors de sa puissance. Par la réflexivité, le chercheur est capable d’examiner les modalités par lesquelles il peut reconstruire le savoir pratique en intégrant dans la théorie l’écart entre la connaissance pratique et la connaissance savante.
Manière de rappeler que des dispositions cognitives communes rendent l’Afrique (re)connaissable et imposent des contraintes avec lesquelles elle doit composer pour survivre, parce qu’elles déterminent la perception que le monde se fait d’elle. Ahmed Nara, dans L’Écart, travaillant à sa thèse de doctorat en histoire sur le peuple kuba, veut « repartir à zéro » et établir des « parcours nouveaux ». Dans sa démarche, il remet en question la production occidentale sur son objet. Pendant dix ans, remontant à des sources parfois ésotériques, il n’avance pas dans ses recherches et il est hanté, parce que précédé, par les discours déjà-là qu’il dénonce. Mudimbe refuse ainsi de se placer en Dieu créateur de l’univers (scientifique), et rejette la mythologie du « créateur incréé ».
Il admet que l’Afrique comme objet et produit de recherche occupe une place particulière au sein du champ scientifique qui l’a produite, qu’elle produit à son tour et dont elle est le fait. Par la réflexivité critique, Mudimbe traduit sa vigilance vis-à-vis de la raison scientifique. En dénonçant les limites que les déterminations sociales et les conditions de production imposent à la science, il se libère des contraintes et des contingences de ce champ : « En ma réflexion sur des conflits de lectures et d’interprétation, je m’attèle à une tâche, celle de me défaire librement de mes masques avant que la mort ne me les pulvérise à tout jamais ». Le penseur se veut un homme libre.
Cette nécessité de chercher à comprendre les conditions sociales de l’émergence de la parole, ses inscriptions, ses prescriptions et ses proscriptions, se pose contre le fétichisme du « projet originel » dont parlait Jean-Paul Sartre. Elle montre, si de besoin est, que les systèmes symboliques dont l’ambition est de prétendre détenir le monopole de la raison triomphante qui assure la validité universelle des énoncés sont produits par des espaces sociaux. Elle fournit pourtant à la pensée de V.Y. Mudimbe la liberté de penser par rapport à ces conditions de possibilité et d’accès (dont il explicite les limites de la pensée) en prenant distance, tout en explorant toutes les adhésions inhérentes aux intérêts liés à la position qu’il occupe en fonction de sa trajectoire et de son habitus.
Cette quête de généalogie est signe d’humilité intellectuelle, car elle rejette la toute-puissance de la pensée qui le conduirait à croire au caractère absolu et transcendantal de son point de vue par rapport à ses devanciers. Elle est acte de reconnaissance des structures objectives du champ scientifique. En somme, l’œuvre de Mudimbe superpose et entrelace de front trois récits : le récit d’un sujet dont le discours affronte une histoire, celui d’un sujet qui confronte l’affirmation de son autonomie avec les contingences de la contemporanéité, enfin celui d’un sujet à la recherche d’un langage qui dise le monde social et pratique.
Au lieu de lire le tiraillement et l’écartèlement de Mudimbe ou de l’intellectuel africain entre deux mondes contradictoires, « entre les eaux » et vivant leur « écart », il faudrait plutôt être attentif à l’ambivalence et à la fonction pragmatique de l’oxymore qui constitue une des stratégies et des forces de son argumentation. L’oxymore lui permet de transcender et de dépasser les antagonismes et la tension de deux valeurs ou deux éléments opposés placés l’un(e) face à l’autre (de l’antithèse) : tradition/modernité, christianisme/paganisme, Afrique/Occident, moi-même/un autre, bien/mal, blanc/noir, martyr/bourreau, pureté/souillure, etc. Grâce à cette figure rhétorique de l’oxymore, Mudimbe articule étroitement deux directions, deux valeurs, deux espaces, deux temps, dont il se démarque en les fusionnant pour les dépasser. Ascète amoureux de ses idées, il traduit là le désir de dépasser le monde concret qui l’entoure.
La réflexion philosophique et sociologique de Mudimbe suggère donc un mixte de prêtre et de révolution, d’Afrique et d’Occident, de christianisme et de paganisme (Entre les eaux. Dieu, un prêtre, la révolution ou L’écart), de beau et d’immonde (Le bel immonde), de père et de fils (L’odeur du père), du royaume et de l’autre face (L’autre face du royaume), du jardin africain et de l’ordre bénédictin (Les corps glorieux des mots et des êtres. Esquisse d’un jardin africain à la bénédictine), de gnose (ce qu’il appelle, simplement, « la chose du texte », notion mystérieuse jamais explicitée et restée comme une énigme, mais à laquelle il confère une force dialectique, que l’on peut assimiler à l’équivalent de la connaissance « sans conscience » de Husserl, ou le sens commun, le savoir pratique de Bourdieu, la « docte ignorance » de l’homme ordinaire. Pourquoi ne pas penser à la phénoménologie que fréquente assidûment Mudimbe, et entendre la gnose comme la chose elle-même, et non le processus de sa production ou de sa perception? C’est la conscience et la conviction qu’il est nécessaire que le mot dise la chose, et que le chercheur incorpore le monde social pour accéder à la connaissance en s’efforçant de mettre en rapport la machinerie conceptuelle avec autre chose qu’elle-même, c’est-à-dire tout ce qui met l’homme, le monde et l’histoire à l’origine du texte, ce que les sociologues de la littérature appellent la socialité du texte ou le battement réciproque entre société du texte et société de référence) et d’épistémè, le savoir savant ou la connaissance consciente (The Invention of Africa. Gnosis, Philosophy, and the Order of Knowledge ou L’écart), de la parabole et de la fable (Parables and fables. Exegesis, Textuality, and Politics in Central Africa), de la foi (religion) et de la performance politique (Tales of Faith. Religion as Political Performance in Central Africa). Obscur et étranger à lui-même, métaphore vive, métonymie géante et anacoluthe vivante glissant d’un régime grammatical à l’autre, de Je à Il, d’un univers social à l’autre, Mudimbe est un autre lui-même, ou lui-même et un autre, à la jointure de divers univers, enfermé dans sa tour d’ivoire. Il récuse toute définition stable et toute prévision. Le sujet devient objet, il se découvre fragmenté, clivé, il invite à le lire par rétroaction et rétrospection.
Pour affronter son avenir, l’Afrique doit analyser et tirer les leçons de son passé, de ses traditions et de ses cultures. En analysant avec érudition la « bibliothèque coloniale », Mudimbe n’invite pas à la brûler, mais à la scruter avec circonspection, dans notre actualité, afin que le miroir réfléchisse à ceux qui en sont les propriétaires ou les descendants leur propre image pour le bien-être de l’humanité. La « bibliothèque coloniale » demeure une arme combattante efficace. Mieux que la clameur du canon, elle assure le rayonnement et la pérennité de la conquête. Elle justifie et rend normale l’instauration d’un ordre nouveau. Elle assujettit les vaincus, les dresse, les formate et les « normalise » selon les lignes de forces invisibles et impérieuses. La bibliothèque coloniale et l’africain nouveau sont solidaires l’un de l’autre.
Aussi Mudimbe somme-t-il le chercheur africain d’investir la science comme sujet, producteur, reprenant ainsi, en l’approfondissant, L’Autre face du royaume à travers la métaphore de l’ascenseur, un analogon de la caverne de Platon. Mudimbe est conscient du rapport prostitutif où la fascination du pouvoir de la bibliothèque coloniale exerce une attraction qui accentue la dépendance et la docilité des corps dominés, leur faisant aimer ce qu’ils dénoncent et qui les écrase. Il recommande au chercheur africain qui se méfie de cette bibliothèque coloniale d’examiner dans quelle mesure il ne la reproduit pas dans sa dénonciation et à travers les distances qu’il veut prendre. Lucide, Mudimbe reprend dans son introduction à L’odeur du père, un passage où Foucault (dans L’ordre du discours) tente de montrer comment les penseurs de son époque voulaient échapper au règne du logos hégélien. Mudimbe remplace dans le passage Hegel par l’Occident et met en garde le chercheur africain désireux de s’éloigner de la pensée occidentale :
(Pour l’Afrique,) échapper réellement à l’Occident suppose d’apprécier exactement ce qu’il en coûte de se détacher de lui; cela suppose de savoir jusqu’où l’Occident insidieusement peut-être, s’est approché de nous : cela suppose de savoir, dans ce qui nous permet de penser contre l’Occident, ce qui est encore occidental; et de mesurer en quoi notre recours contre lui est encore peut-être une ruse qu’il nous oppose et au terme de laquelle il nous attend, immobile et ailleurs.
Mettant en présence deux mondes, Mudimbe décrypte, dans son cheminement, leurs relations secrètes.
Son œuvre est une réflexion profonde sur la « pensée relationnelle », un appel à continuer à rechercher le sens de la vie en partage avec d’autres civilisations et de ses valeurs. Au faîte d’un patient et dur labeur d’objectivation de soi, Mudimbe confie le sens à l’opacité d’une recomposition imaginaire de ce qu’il dit dans la transparence. Tout en étant conscient que cette bibliothèque coloniale constitue à travers son écran séducteur une menace pour l’ordre social mondial marqué par l’exploitation, les abus et les perversions, son décryptage est une façon élégante pour V.Y. Mudimbe de dire qu’aucune raison ne justifie une lutte frontale entre l’Occident et l’Afrique. Au contraire, il convient de s’interroger sur la légitimité des places (« un sens de place », dit Erving Goffman) de chacun de deux partenaires, en prenant acte et en affirmant la différence fondée sur l’autonomie, l’indépendance, le respect et l’égale dignité de chacun. Ainsi, la bibliothèque coloniale traduit une problématique de l’échange, du valoir, de la valeur marchande des signes du discours, du t(r)oc, entendu au-delà du sens trivial du mot.
Le fait même d’analyser les discours occidentaux sur l’Afrique est une façon pour Mudimbe de chercher à trouver un terrain d’entente entre les deux faces de son identité, ses deux mémoires, marquant ainsi un moyen de communication entre son existence et son travail professionnel. En d’autres termes, l’Afrique et l’Occident ne peuvent pas se penser l’un sans l’autre. S’il y a impossibilité à connaître l’autre, il est un impératif de le reconnaître. Il faudrait accepter et reconnaître l’irréductibilité de l’autre et admettre son étrangeté et son mystère sans chercher à le connaître, accepter l’autre tel, comme, et pour ce qu’il est, se penser en pensant l’autre. L’obsession et l’aliénation de cette (inter)dépendance marquent les rapports entre l’Occident et l’Afrique, comme si leurs destins étaient liés. La géométrie de l’érudition à travers la démonstration de cette « bibliothèque coloniale » permet à son auteur de dépasser son anxiété et son inquiétude (dues à l’aliénation) et d’entrer dans une relation spéculaire par laquelle il donne à lire que l’Afrique et l’Occident se produisent réciproquement. Ils sont tellement liés que leur conjonction fait des aspects de leur disjonction un art de vivre et brise l’attitude de domination. Le sujet se disloque ; l’identité se désagrège et éclate en multiples agrégats.
Les deux doivent donc se mettre à l’œuvre et dépasser l’épreuve que la « bibliothèque coloniale » a créée entre eux, sortir des replis de leurs subjectivités respectives, afin de transcender l’échec de leur relation initiale, pour que chacun s’engage résolument dans le rapport à l’autre, valorise la relation transactionnelle et imagine des situations réciproquement enrichissantes. C’est à un réaménagement du commerce relationnel qu’appelle la « bibliothèque coloniale » entre le dominant et le dominé, afin que chacun prenne conscience du caractère irréductible de l’altérité de l’autre sans la radicaliser.
L’un et l’autre doivent interroger l’histoire et ses présupposés essentialistes, l’histoire collective dont nous tenons nos catégories de pensée, et l’histoire individuelle par laquelle nous les avons apprises. Le dominant devra réajuster l’emprise incorporée et ses présupposés du pouvoir symbolique qu’il exerce sur le dominé, s’efforcer de le rejoindre. Il revient au dominé de revoir sa perception de lui-même à travers le miroir de la « bibliothèque coloniale ». L’un et l’autre doivent accepter la coexistence et une double appartenance. L’homme ne peut atteindre la grandeur que s’il prend conscience qu’il est misérable, c’est-à-dire marqué et déterminé par les structures sociales qui le structurent, mais qu’il s’efforce de transcender.
Dans une sorte d’échancrure du grand Texte, Mudimbe va en quête du « noyau traumatique » à partir duquel il a pu appréhender le monde et le rendre intelligible, c’est-à-dire la manière dont ses corps graphiques s’efforcent de s’approprier le corps « bio-graphé ». Le secret de son investissement dans son travail scientifique qu’il prend pour un sacerdoce, Mudimbe le fait remonter à son habitus comme présence du passé dans son présent, c’est-à-dire à son arrachement précoce de la cellule familiale – d’où l’obsession contenue du manque de la mère notamment – , au cadre de son enfance lié à son introduction à la vie bénédictine qui fut aussi pour lui une « école de discernement ». Manière de dire que s’il ne peut pas savoir où il va, il sait au moins d’où il vient. En exprimant son inscription originelle par l’aveu de son appartenance à un ordre, il reconnaît que cet ordre fait sens pour lui et nimbe tout son cheminement de son aura. Mudimbe fait de sa trajectoire l’élection du destin. Comme son existence a bien sculpté son œuvre, il laïcisera plus tard la « trame » bénédictine, la devise Ora et labora (Prie et travaille), et l’adaptera à son emploi de temps pour s’intégrer dans la culture de « productivité d’usine » de l’université américaine tout en préservant la qualité de sa production scientifique. En fait, aristocrate d’esprit, Mudimbe prend la revanche, grâce à son reclassement symbolique, sur son déclassement social. Il ne faudrait pourtant pas prendre au pied de la lettre l’ironie, l’humour et la fantaisie avec lesquels il joue et s’amuse de son ascension sociale en devenant bénédictin, tout en la déjouant.
Même le fait d’avoir enlevé l’habit de moine, tout en continuant à réagir, dans ses réflexes, jusque dans sa coiffure et son habillement noir (des dernières années), comme bénédictin, participe de cette fable, ressassée à l’envi par lui-même et par des analystes qui se limitent à constater son occidentalisation. Ces procédés ont, pourtant, pour fonction, à travers le douloureux acte d’objectivation de soi sous des formes détournées et excentriques, de déchiffrer le lieu géométrique de son positionnement tel qu’il se vit et tel qu’il se rêve. Comme si Mudimbe voulait nous dire qu’il a édifié sa vie sur un malentendu, un quiproquo. Bénédictin, il veut en être (dans toutes ses représentations et sa symbolique), sans toujours aussi en être, préférant les marges, pour éviter de se compromettre avec ce statut. S’il tente d’entrer dans le jeu, il ne veut pas se laisser prendre au jeu, tout en resserrant, à son insu, les mailles du filet tendu sous ses pieds dans lequel le jeu le prend.
Le chemin de traverse qu’il a emprunté pour s’écarter de l’ordre l’y a ramené. Prodigieux enfant prodigue de l’ordre, il ne se défera jamais d’une discipline et d’une vision initialement acquises. Fût-ce ironiquement, Mudimbe rappelle ce dont il hérite et qui a favorisé l’émergence de sa parole au moment même où il s’en détache. Comme par une sorte de déterminisme, l’ordre survit en fantôme tenace de son discours. Puisque « Le fils ne tue pas le père », il n’en finit pas de reconduire l’image (« l’odeur »?) du père. On ne peut impunément abattre la statue de pierres du Commandeur sans la convoquer sans cesse et sans la conjurer à satiété in praesentia. Prenant ainsi acte de cette cause originelle, Mudimbe s’écarte de l’histoire de sa révolte et de sa frustration qui l’obsédaient et le repliaient sur lui-même, pour la concevoir comme un refus de déterminer l’ensemble ders comportements humains. Apaisé, il réalise que la rupture qu’il voulait réside dans la prise en compte et l’acceptation de l’être-là du monde et de son absurdité, qu’il ne faut pas chercher à expliquer, mais qu’il faut reconnaître dans son mouvement incessant et aléatoire, accidentel et arbitraire.
Soulignons, enfin, la bonté, la générosité, l’humilité et l’humour de V.Y. Mudimbe. Il a fait don de son immense et foisonnante bibliothèque à l’Université de Lubumbashi. Fatigué et affaibli par la médication qu’il prenait à la suite du diagnostic de cancer qui s’est révélé erroné, Mudimbe déploya beaucoup d’énergie dans la direction des travaux de maîtrise et de doctorat, dans l’espoir d’inspirer à ses disciples son esprit et sa foi pour la qualité de la formation à l’université, malgré la décomposition socio-politique du Congo. Il investira des années durant son temps et sa patience pour guider les étudiants dans les universités américaines et ailleurs.
À l’université Laval où il venait régulièrement, mes étudiants de maîtrise et de doctorat n’entendaient pas que le séminaire de 3 heures animé par le Maître se termine. Ils restaient à côté de lui pendant des heures, l’accompagnaient au restaurant, appréciant son humilité, l’érudition et la sagacité de l’intellectuel, la simplicité et l’étrange charmant sourire de l’homme. En sa compagnie, ils se sentaient distingués et rayonnants, partageant sa passion. À son retour, ils échangeaient avec lui… Il prenait le temps d’écrire à chacun d’eux, leur envoyant des cadeaux, tissant avec chacun une relation personnelle. Décidément, ce savant austère était aussi un amoureux fervent et soucieux de l’homme.
Malgré l’échec des dirigeants africains et les mises en garde de la raison, Mudimbe, pessimiste de l’esprit, mais optimiste de la volonté, gardait sa foi en l’homme et sa confiance en l’avenir:
Je me remets à vous, mes anciens élèves et, à présent, amis, collègues, mes égaux. Il y a une foi à transmettre à la génération qui monte. Un esprit aussi. Je vous sais sevrés de naïvetés à propos des « traditions africaines ». Je sais, aussi, que vous avez épuisé tous les secrets de la patience pour croire encore qu’il y a une limite aux coups de vos colères et à ceux de vos espoirs pour une meilleure Afrique. Vous avez raison d’espérer, malgré la bêtise générale qui nous entoure.
Plutôt que d’être un serviteur du prince, V.Y. Mudimbe s’est assigné la tâche de servir et d’éclairer le public, de porter la lumière, en se gardant d’être un marchand de rêves, un pourvoyeur d’espoirs ou un berceau d’illusions. Il a invité le chercheur africain à méditer sur l’histoire immédiate en train de se faire, à se nourrir de l’éthique de la responsabilité qui implique des convictions, la connaissance des circonstances du monde qui l’englobe et dans lequel il est inclus, à le juger avec équité, tout en prévenant qu’on ne doit pas se servir de la raison dialectique pour justifier l’injustifiable ni faire accepter l’inacceptable.
Par ses positions, Mudimbe a montré l’exemple, même si, chez ses personnages romanesques, rien n’aboutit, et que chaque acte est un échec et un recommencement. Célibataires mélancoliques, enfermés dans des espaces clos (entre le rêve et le réel) dont ils sont des prisonniers libres (couvent, monastère, bibliothèque, maquis, bar, dispensaire, bureau, etc.) d’où ils observent et voient le monde sur lequel ils jettent un regard ironique, ils rythment quotidiennement leurs vies et leurs existences par de petits faits et de petits riens, faisant stagner la narration minimaliste, au déshabillé diégétique, jusqu’à faire dénouer l’intrigue par un coup de force, une sorte de deus ex machina. Leur farouche volonté de combat est généralement contrecarrée par d’innombrables facteurs de leur impuissance dont ils se délectent avec complaisance. Toute tentative d’action se veut inaction. Mais ces personnages figurent une âme en quête de sa grâce.
Leur grandeur et leur universalité tiennent à leur capacité à métaphoriser avec éclat la transformation quotidienne de l’espoir en détresse et de la sagesse en aveuglement volontaire, réalisant que la vie n’est qu’un lent et horrible apprentissage de la mort. Ils ont néanmoins laissé chaque lecteur exercer sa liberté et assumer ses choix. Plutôt que d’enflammer les cœurs, ils ont préféré viser à être les éclaireurs des esprits et à veiller à ne pas promettre un pays ruisselant de lait et de miel. C’est pour cela qu’ils diagnostiquent, sans proposer un traitement. Le remède qu’ils essaient ne guérit pas. Modestes, frémissants et conscients de leurs limites, ils savent que la lumière dont ils sont porteurs n’est pas celle de l’éclair, mais celle de la bougie dont la flamme vacille et que l’on doit rallumer continuellement. Leur créateur n’a pas été envoûté par le rêve d’une révolution totale qui accoucherait d’un monde de merveilles qui relève d’une vision romantique. Exalté par le marxisme, Mudimbe s’en est méfié très tôt. Il savait que l’utopisme politique qui proclamait l’avènement du bonheur pour tous en promettant de transformer le présent médiocre en un avenir radieux s’est révélé être un remède pire que le mal qu’il voulait guérir.
En analysant les comportements humains qui accompagnent les bouleversements historiques, il a montré, à travers certaines figures emblématiques que l’histoire des nations a produit des monstres à la psychologie problématique et aux agissements sinistres, quoiqu’à des degrés divers, d’un continent à l’autre. Une commune conception du monde les meut, celle qui prétend détenir la recette d’une création suprême, qui fait fi des manières de vivre et de créer antérieures et qui perçoit tout en opposition binaire, en radicalisant la différence, de façon à supprimer un des termes de l’antithèse qu’ils créent. Alors la terreur qu’ils instaurent règne et produit le désastre social, dès que l’on veut transformer l’idéal, qui doit rester un horizon d’attente, en règle de vie quotidienne.
Bénédictin sans l’être, Mudimbe n’a pas la prétention d’apporter une vérité révélée, et sa pensée, dont il n’a jamais fait un système, ne peut pas tout expliquer, malgré sa clarté et sa lucidité. Il réalise ainsi une osmose entre le penseur et l’artiste, le philosophe et le créateur, gommant les distinctions entre les méthodes et les objets, connectant les domaines, abolissant les frontières conventionnelles entre les disciplines dont il favorise l’interpénétration jusqu’à les confondre dans la même curiosité insatiable et le même engagement de l’esprit. Au-delà de sa volonté de comprendre et de connaître le monde, V.Y. Mudimbe nourrit, par-delà tout scepticisme, une haute idée de l’humanité à laquelle il porte un amour profond. Pour ces raisons et tant d’autres, nous lui devons toute notre reconnaissance.
Justin Bisanswa
-
Association de recherche
- arsc
- bigsas
- ciéf
- Oudjat
- sfps
- sielec Base de données littératures francophones
- francofil
- La décolonisation des savoirs
- limag
- litaf Librairies/Editions
- Oudjat Pôles de recherche
- labos univ-metz
- msha
- u-cergy Revues
- africultures
- ingentaconnect
- motspluriels
- JUSTIN BISANSWA REND HOMMAGE �...
- Justin Bisanswa rend hommage �...
- COLLOQUE INTERNATIONAL EN HOMM...
- PRISCA OTOUMA (OBSOLESCENCE, �...
- SAMI TCHAK-LES VOIES D’U...
- SÉBASTIEN HEINIGER (DÉCOLONI...
- SAMI TCHAK : LES VOIES D’...
- APPEL À COMMUNICATIONS
- UNIVERSITÉ OMAR BONGO (LIBREV...
- COLLOQUE INTERNATIONAL EN HOMM...
- UNIVERSITÉ DE LORRAINE: JOURN...
- REVUE ÉTHIOPIQUES: APPEL À C...