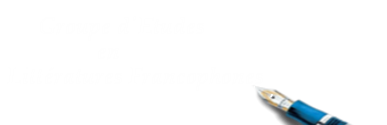Senghor entre Francophonie et dialogue interculturel
Résumé:
Négritude, for sale Francophonie et dialogue des cultures sont des concepts chers à Senghors et qui cristallisent la quintessence de son œuvre littéraire et poétique. Après avoir lancé le mouvement de la négritude dans les années 30 pour combattre la domination coloniale et affirmer les valeurs culturelles noires, prostate Senghor dont l’idéal humaniste n’est plus à démontrer, fonde avec d’autres camarades le mouvement de la Francophonie pour œuvrer à une véritable coopération culturelle, politique et socioéconomique entre les pays francophones et l’ancienne puissance coloniale. Ces deux concepts – Négritude et Francophonie – n’ont de sens, selon Senghor, que s’ils débouchent sur un dialogue enrichissant, fructueux et productif entre les peuples, nations et cultures de toute la surface de la terre.
La présente étude se propose d’analyser le rôle que Senghor a joué à la naissance et au rayonnement de la Francophonie par le truchement de la langue française et se focalise également sur sa contribution décisive au dialogue interculturel.
Mots-clés: Négritude, Francophonie, dialogue interculturel, Civilisation de l’Universel, métissage, diversité culturelle, multiculturalisme, langue française.
Abstract:
Negritude, Francophonie and dialogue of cultures are favored concepts of Senghor and crystallize the essence of his literary and poetic work. After having launched the movement of negritude in the 30s to fight the colonial domination and assert the black cultural values, Senghor whose humanistic ideal is not any more to show, founds with other like-minded persons the movement of the Francophonie to work a true cultural, political and socio-economic cooperation between francophone countries and the farmer colonial power. These two concepts – Negritude and Francophonie – do not make sense, according to Senghor, that if they emerge in an enriching, profitable and productive dialogue between the nations and cultures of all the surface of the ground.
The present study proposes to analyze the role that Senghor played to the birth and radiation of Francophonie by the means of the French language also focuses on his decisive contribution to the intercultural dialogue.
Keywords: Negritude, Francophonie, intercultural dialogue, universal civilization, miscegenation, cultural diversity, multiculturalism, French language
INTRODUCTION
L’écrivain et poète sénégalais Léopold Sédar Senghor est, sans nul doute, l’un des plus influents penseurs et théoriciens du mouvement de la négritude pour avoir pris une part active à sa naissance et à son évolution. Et pourtant, il a également contribué de manière décisive à la naissance de la Francophonie, devenant du coup l’un de ses plus importants fondateurs et théoriciens. En effet, le nom de Senghor est quasi indissociable avec celui de la Francophonie, si bien qu’il a dû essuyer des critiques acerbes de la part de certains détracteurs de la Francophonie à cause de son engagement pour ce concept, qui est sous-tendu par son amour pour la langue française. Au-delà de la Francophonie, Senghor s’est efforcé durant toute sa vie, d’initier et de réaliser un dialogue fructueux et enrichissant entre toutes les cultures, tous les peuples du monde, sans distinction de race, de couleur ou d’origine.
La présente étude se propose de revisiter d’une part les différentes péripéties de la naissance et de l’évolution de la Francophonie et la contribution décisive de Senghor à son éclosion et rayonnement. D’autre part, elle passe en revue les objectifs que les fondateurs avaient assignés à ce mouvement avant d’analyser le rôle de premier plan que Senghor a joué dans le dialogue interculturel.
1. La Francophonie: Essai de définition
Le mouvement de la Francophonie fut porté sur les fonts baptismaux par Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Habib Bourguiba de la Tunisie, Hamani Diori du Niger et Prince Norodom Sihanouk du Cambodge. Cependant, il s’avère important et nécessaire de préciser que le concept de Francophonie désignant la communauté des pays ayant la langue française en commun fut forgé par le géographe et géopoliticien français Onésime Reclus dans le but de favoriser l’expansion coloniale à la fin du 19e siècle (1880). Par le terme Francophonie, il voulait désigner la communauté culturelle de l’empire colonial français. Il entendait par le mot « francophone » celui qui parle le français et par le terme « francophonie » l’espace où la langue française est utilisée comme moyen d’expression.
Senghor et les adeptes de la Francophonie procédèrent à une réinterprétation, réévaluation, à un recadrage du sens géographique et géopolitique originel du concept de Francophonie. La propagation et la dimension transnationale de la langue française que Reclus a constatées et mises en exergue dans sa conception de la Francophonie est tout d’abord un effet, une répercussion de la conquête coloniale française. La langue française permet ainsi l’exercice et la stabilisation de la domination coloniale. La particularité entre autre de la réinterprétation du concept de Francophonie initiée par Senghor et ses camarades repose de ce fait sur une redéfinition de la langue du colonisateur comme moyen de communication égalitaire, décentralisée et transnationale. Dans son œuvre ce que je crois, Senghor se fait plus précis sur la naissance de la Francophonie:
C’est donc en janvier 1944, et par la volonté de Charles de Gaulle que naquit non seulement l’idée et la volonté, mais surtout la possibilité de la Francophonie… C’est ainsi du moins que nous lavions compris Habib Bourguiba, Hamani Diori et moi.
La Francophonie se révèle être, selon Senghor et ses camarades, une organisation politique, socio-économique et culturelle dont le but est de faire découvrir et de promouvoir la culture de ses pays membres, en renforçant la coopération technique et culturelle entre eux. La Francophonie est, dans cette optique, un humanisme qui puise sa sève nourricière de tous les coins du globe. Senghor voulait à tout prix, et ce à juste raison, éviter l’amalgame entre défendre la Francophonie et cautionner l’impérialisme colonial. En effet, par ce concept il aspirait à une coopération active et fructueuse avec l’ancienne puissance coloniale au plan technique et culturel. La Francophonie se doit de promouvoir l’autonomie et le développement socioculturel des peuples indigènes et de mettre à leur disposition dans la langue française un moyen supplémentaire pour l’articulation et l’épanouissement de leur propre culture. Dans son discours de réception du titre de docteur honorifique que lui a décerné l’université Laval du Québec, Senghor précise sa conception de la « Francophonie » :
Qu’est-ce que la Francophonie? Ce n’est pas, comme d’aucuns le croient, une » machine de guerre montée par l’Impérialisme français «. Nous n’y aurions pas souscrit, nous Sénégalais, qui avons été parmi les premières nations africaines à proclamer et pratiquer, nous ne disons pas le «neutralisme positif», mais le non-alignement coopératif.
Il urgeait pour Senghor de prévenir la confusion entre la Francophonie et une nouvelle politique néocoloniale et impérialiste. Dans un discours prononcé lors d’une conférence sur la Francophonie en 1985 à Paris, Senghor livre une définition triptyque du concept:
[…] Le mot de « francophonie » avec ou sans f majuscule peut signifier:
1. l’ensemble des Etats, des pays et des régions qui emploient le français comme langue nationale, comme langue officielle, comme langue de communication internationale ou simplement comme langue de travail ;
2. l’ensemble des personnes qui emploient le français dans les fonctions que voilà ;
3 .la communauté d’esprit qui résulte de ces différents emplois.
Les efforts de Senghor pour la mise en œuvre du concept de Francophonie se justifient par sa volonté et sa quête d’un facteur de rapprochement entre les cultures et civilisations. Il soutient que la Francophonie est une occasion, une possibilité pour le continent africain de participer « à la renaissance du monde, de s’ouvrir aux autres, d’aller à la rencontre de l’humanité »
2. Le rôle de Senghor à la naissance de la Francophonie ou Senghor acteur et bénéficiaire de la Francophonie
Senghor est sans aucun doute possible une figure emblématique de la Francophonie. Il fait figure jusqu’à présent de père-fondateur et théoricien le plus éminent du concept de Francophonie. D’ailleurs, c’est à juste titre que René Gnalega (2002) le considère dans son article Senghor et la Francophonie comme « le principal acteur et bénéficiaire de la Francophonie ». En effet, l’engagement de Senghor pour la Francophonie est manifeste. Les textes, articles et discours suivants témoignent de l’implication volontariste de Senghor pour ce concept : La francophonie comme culture. In: Liberté III, pp. 80–89; La Francophonie comme contribution à la Civilisation de l’Universel. In: op. cit., pp. 183–194. Pour un humanisme de la francophonie. In: op. cit., pp. 542–552 ; La francophonie et le français. In: Liberté V. Le dialogue des cultures, pp. 133–144 et De la francophonie à la francité. In: ebd., pp. 261–273.
L’investissement de Senghor pour la Francophonie s’explique par le fait qu’il la considère tout d’abord comme une culture qui aspire à identifier les problèmes de l’humanité et à leur trouver des solutions. Par conséquent, il assimile la Francophonie à la francité qui englobe et inclut la dimension culturelle: « La Francophonie – plus précisément, la Francité, c’est une façon rationnelle de poser les problèmes et d’en rechercher les solutions, mais toujours par référence à l’homme. »
Apres avoir souligné la richesse de la langue française, Senghor la présente au monde entier pour prôner et réaliser une synthèse culturelle, une symbiose entre les peuples et cultures. Il défend l’idée selon laquelle, la langue française est un appel, une invitation à la Civilisation de l’Universel, à une communication interculturelle et transnationale, au rendez-vous du donner et du recevoir. Ainsi, la Francophonie est, au sens senghorien « une communauté spirituelle: une noosphère autour de la terre. »
Avec le concept de Francophonie, Senghor ne voulait en aucun cas occulter ou perdre de vue les valeurs, la richesse des langues et cultures négro-africaines. L’ouverture aux peuples et cultures qu’il prône n’exclut nullement de conserver, de garder jalousement et de priser ses propres valeurs linguistiques et culturelles « car, pour demeurer nous-mêmes, nous devons conserver les vertus de l’humanisme nègre dont nos langues sont dépositaires. » Ces propos expliquent à suffisance le recours récurrent de Senghor aux mots et expressions négro-africains dans ses poèmes et écrits. Cependant, il souligne l’importance, la nécessité de réaliser une synthese harmonieuse entre les langues et valeurs indigènes et celles occidentales (en particulier de la langue française). Il s’agit en effet, selon Senghor, d’opérer un échange réciproque, une appropriation mutuelle de valeurs culturelles et linguistiques. Dans Liberté V, il s’exprime ainsi:
En vérité, loin de rejeter brutalement, stupidement, les valeurs de l’Occident européen, il nous fallait faire un tri parmi elles pour ne choisir que celles que nous pouvons assimiler, dont nous pourrions tirer profit. D’où ma formule: Assimiler, non être assimilé.
D’après la conception de Senghor, la Francophonie doit favoriser et permettre une cohabitation fructueuse et enrichissante entre la langue française et celles autochtones. La Francophonie doit être, dans cette optique, la force motrice d’une coopération technique entre ses différents membres et ouvrir la voie à un dialogue fructueux et enrichissant entre les peuples à travers leurs langues et civilisations pour « exprimer une authenticité culturelle, d’homme du vingtième siècle. » La Francophonie est pour ainsi dire un modèle d’échanges d’idées qui prend en considération la particularité et l’individualité de chaque nation. Senghor met l’accent sur la fonction unificatrice de la Francophonie qui consiste à œuvrer pour le métissage culturel entre les différents peuples, les différentes nations. Dans son article intitulé Pour un humanisme de la Francophonie, Senghor fait valoir clairement cette vertu multidimensionnelle et enrichissante de la Francophonie:
L’idée est la même: au-delà d’un possible métissage biologique – qui était réel à Gorée et Saint-Louis du Sénégal, mais là n’est pas l’important – il est question, essentiellement, d’un métissage culturel. C’est ce sentiment communautaire qui prévaut dans toutes les rencontres francophones.
Senghor ambitionne, avec le programme conceptuel de la Francophonie, de mettre sur pied, d’édifier une communauté culturelle à laquelle vont pendre part tous les pays qui utilisent le français comme une de leurs langues officielles pour articuler des valeurs linguistiques et culturelles communes. Dans cette communauté, aucune nation ne donne le ton, ne domine. Chaque nation a le droit, la liberté de glisser toute valeur particulière dans sa propre langue. Senghor appelle ainsi à une solidarité culturelle au moyen de laquelle la Francophonie puisse devenir un instrument d’épanouissement, de liberté et d’échange réciproque. Dans ce sillage, Senghor souligne de façon explicite le respect de certains principes tels que l’égalité et la réciprocité:
L’idée de solidarité culturelle exclura tout complexe de frustration, toute forme de surenchère, toute politique de bascule, d’humeur ou de mendicité. Le problème n’est pas de partager un héritage, mais d’édifier, entre nations majeures, une véritable communauté culturelle (C’est Senghor qui souligne).
Le concept de Francophonie traduit également l’intérêt et l’amour de Senghor pour la langue française pour laquelle il fut sévèrement critiqué. Senghor n’aimait pas seulement la langue française, mais la maitrisait. Ce n’est point un hasard, qu’on lui chargeât de corriger stylistiquement la constitution française. En recourant au concept de Francophonie, Senghor manifeste sa passion et sympathie pour la langue de Molière. Senghor fait incontestablement partie de ceux qui ont revitalisé la langue française et contribué à son épanouissement, à son rayonnement. Il insiste dans Liberté III sur le rôle influent que les écrivains négro-africains ont joué pour l’épanouissement de la langue française:
C’est un fait, le français nous a permis d’adresser au monde et aux autres hommes, nos frères, le message inouï que nous étions seuls à pouvoir lui adresser. Il nous a permis d’apporter à la Civilisation de l’Universel une contribution sans laquelle la civilisation du XXe siècle n’eût pas été pan humaine. Il lui aurait manqué cette chaleur de l’âme qui fait l’authenticité de l’homme.
En dévoilant la richesse de la langue française, et par ricochet de la francité et de l’Europe, Senghor fait allusion à une rencontre, à une coopération enrichissante et complémentaire. L’Afrique s’enrichit des valeurs de l’occident, qui lui aussi fait de même avec celles de la négritude. Ceci permettra à toutes les nations de prendre part, de contribuer à cette communication transnationale et interplanétaire. Senghor s’est engagé de manière inlassable aussi bien dans son œuvre littéraire et poétique que dans sa carrière politique à servir la Francophonie et la négritude, de faire connaitre et valoir leurs valeurs respectives, car personne n’était plus habilité que lui, à révéler les valeurs de part et d’autre.
3. Objectifs et défis de la Francophonie
Après le combat pour l’affirmation et la glorification des valeurs de la négritude, Senghor sentit la nécessité de réaliser un dialogue, un échange fructueux entre les peuples et cultures. Pour atteindre cet objectif, Senghor s’appuie sur deux concepts centraux, qui sont d’une importance particulière pour ce projet: la Civilisation de l’Universel et la Francophonie. La Francophonie a, à l’origine, une fonction culturelle et n’est pas seulement un organe pour le maintien et la pérennisation de la langue française dans le monde, mais aussi une sorte de mondialisation humaniste. Elle se veut un instrument de rapprochement mutuel entre les peuples et cultures, du dialogue interculturel, dont le médium est la langue française. Selon Senghor « il est question de nous servir de ce merveilleux outil, trouvé dans les décombres du Régime colonial. De cet outil qu’est la langue française. »
La Francophonie aspire à la réalisation d’une symbiose culturelle fructueuse entre les nations, d’une conciliation des contraires ou de l’accord conciliant d’après les propres termes de Senghor. A la place de l’opposition à l’ancienne puissance coloniale, Senghor préconise une coopération culturelle, politique et économique à travers le concept de la Francophonie. Il est d’avis que les nations africaines doivent consolider et renforcer leurs relations avec l’ancienne puissance coloniale:
Je pense que pour préparer le futur, il faut encore une fois résister aux idéologies montées à l’assaut de l’Afrique car c’est là notre plus grand danger. Il n’est pas question de s’enfermer dans un ghetto mais – nous en sommes sortis – nous croyons, et nous le disons, que l’avenir est au métissage, ainsi j’admets, nous admettons, nous recommandons même d’accueillir les apports étrangers. L’essentiel c’est une fois les apports étrangers admis, même sur le plan politique, une fois admises les idéologies étrangères, le socialisme par exemple, de l’assimiler en Nègre et pour les Nègres et c’est cela l’essentiel. C’est la raison pour laquelle il nous faut mettre la culture avant la politique.
La Francophonie regroupe 77 : 57 pays-membres et 20 pays observateurs et se nomme Organisation Internationale de la Francophonie. Elle joue le rôle d’une communauté politique et culturelle et entretient une coopération étroite avec d’autres institutions et organisations semblables. Au-delà de la pratique, culture et la pérennisation de la langue française, la Francophonie se fixe comme objectif de promouvoir la paix dans ses pays-membres et aussi dans le reste du monde. C’est en ce sens que son secrétaire général s’engage dans la prévention et résolution des conflits dans le monde entier. Dans un autre registre, la Francophonie s’efforce de consolider et de renforcer la coopération aussi bien entre ses pays-membres qu’entre les pays non membres dans le domaine du développement. Ainsi, le respect de la diversité culturelle est également un défi majeur de la Francophonie qui ne peut atteindre ses objectifs de dialogue et d’échange interculturel que dans le respect de la diversité culturelle et des valeurs des autres peuples et cultures. Cet aspect qui occupe une position centrale dans les objectifs assignés à la Francophonie trouve toute son expression dans ces propos de l’ancien Chef d’État français Jacques Chirac:
Die Frankophonie ist berufen, alle anderen Sprachen der Welt zu versammeln, damit die kulturelle Vielfalt, die sich aus der linguistischen Vielfalt ergibt, bewahrt wird (…). Wir müssen Kämpfer für den Multikulturalismus sein, um die Erstickung der verschiedenen Kulturen durch eine einzige Sprache zu bekämpfen.
Il ressort de l’analyse de cette pensée pertinente de Chirac la dimension capitale de la diversité culturelle et du multiculturalisme qui respectent et reconnaissent l’altérité. Senghor s’est approprié ses valeurs et efforcé dans son œuvre littéraire et poétique de promouvoir aussi bien la diversité culturelle, le multiculturalisme que l’altérité. Le respect de ces valeurs est d’une grande importance pour la mise en œuvre et la réalisation du dialogue interculturel. Senghor souligne à cet effet le choix libre de pouvoir se mouvoir dans plusieurs langues. Cela permettra, dit-il, de converger vers l’Universel:
Nous, politiques noirs, nous, nous nous sentons, pour le moins, aussi libres à l’intérieur du français que dans nos langues maternelles. Plus libres en vérité, puisque la liberté se mesure à la puissance de l’outil, à la force de création. […] Il est question d’exprimer notre authenticité de métis culturels, d’hommes du XXe siècle.
En dépit des critiques véhémentes auxquelles il a dû faire face, Senghor n’a jamais occulté, ne s’est jamais détourné de son objectif à savoir son combat et pour la Négritude et pour la Francophonie. Avec le concept de Francophonie, Senghor a voulu mettre sur pied un programme culturel, politique et économique au profit des pays francophones, qui ne défend pas seulement leurs intérêts, mais les ouvre à un dialogue, à un échange fructueux d’idées, de valeurs linguistiques et culturelles avec l’autre. La Francophonie est, au sens senghorien, un instrument pour le développement d’une véritable coopération entre ses membres dans les domaines de l’éducation, de la culture, des sciences et techniques. La Francophonie est, en d’autres termes, un projet d’humanisation du monde face aux répercussions de la mondialisation. Senghor avait attribué à la Francophonie une fonction unificatrice, qui doit œuvrer pour un dialogue fructueux, un échange enrichissant d’idées, de valeurs linguistiques et culturelles entres les peuples et nations.
4. Senghor: précurseur et apôtre du dialogue interculturel
Un regard rétrospectif et transcendant sur l’œuvre littéraire et poétique de Senghor laisse apparaitre son intérêt particulier pour les littératures et cultures étrangères. A travers son étude exhaustive et diversifiée des œuvres littéraires, des valeurs culturelles d’autres peuples, il a apporté une contribution précieuse et décisive au dialogue entre les cultures et joué un rôle de premier plan dans la formation et la réalisation de la communication interculturelle. Senghor a consacré sa vie et son œuvre à trois concepts majeurs, entre lesquels existe une étroite et logique interdépendance: la Négritude, la Francophonie et le dialogue des cultures. D’ailleurs, son concept de Civilisation de l’Universel est un champ de recherche translittéraire qui offre des perspectives interculturelles d’une actualité brulante et d’un intérêt particulier eu égard au processus de mondialisation, au débat sur le postcolonialisme et à la communication interculturelle.
Son idéal humaniste, son amour du prochain et sa conception universaliste l’ont poussé sans doute à s’ouvrir aux autres peuples et cultures. Pour la concrétisation de cet idéal, il s’appuie sur son concept de Civilisation de l’Universel. Avec ce concept qui cristallise la quintessence de sa pensée, Senghor se donne les moyens de transcender et de dépasser les frontières existantes, fussent-elles géographiques, historiques, linguistiques et culturelles. La Civilisation de l’Universel est, selon lui, d’une grande importance et nécessité car elle surmonte les barrières et frontières nationales et enclenche une communication, un dialogue productif entre les peuples et cultures. Par ce concept, Senghor appelle à franchir les barrières culturelles et linguistiques et à mettre en œuvre un échange mutuel et fécond entre les peuples à travers leurs particularités et valeurs culturelles. Cependant, il souligne de manière péremptoire que les peuples et cultures doivent avoir la possibilité de préserver leurs particularités, leurs différences et de les présenter aux autres cultures et civilisations dans le but d’opérer un échange, un dialogue enrichissant et fécond. Selon Senghor, le dialogue et l’échange se caractérisent par deux aspects certes différents, mais tout aussi complémentaires qui forment un processus de rapprochement entre les peuples. Le dialogue consiste à la fois, dit-il, à s’enraciner dans ses propres valeurs culturelles et à s’ouvrir aux apports féconds des autres civilisations et cultures. De ce fait, l’enracinement et l’ouverture marquent les deux étapes décisives et incontournables de tout processus d’échanges. Senghor l’exprime dans La poésie de l’action comme suit:
Qu’il faut d’abord s’enraciner dans son terroir, sa culture, pour, à partir de là, assimiler, par cercles concentriques de plus en plus larges, avec les civilisations, toutes les autres cultures, différentes.
Cette pensée est caractéristique de la poésie de Senghor qui ouvre un pont entre le soi et l’autre et appelle les peuples et nations à un échange réciproque d’idées et de valeurs linguistiques et culturelles. Senghor forge ainsi le concept de Civilisation de l’Universel « le plus profondément enracinée, mais ouverte aux quatre vents de l’esprit qui soufflent des pollens variés, mais complémentaires » pour promouvoir l’interculturalité. Il s’appuie de ce fait sur le métissage qui fait partie de ses thèmes favoris et récurrents. Il incarne en lui-même un métis biologique, s’efforce à unir deux cultures et se définit comme un « métis culturel, donc comme un homme soumis à plusieurs influences dont celle de l’Afrique (Sénégal) et celle de l’Occident (France). » Senghor accorde une grande valeur au métissage qui parcourt toute son œuvre. Son biographe Armand Guibert souligne ainsi l’idée que Senghor se fait du métissage:
S’il unit dans une commune admiration Claudel et les griots de son pays, Saint John Perse et les ménestrels américains, c’est qu’il a une conception œcuménique de l’homme et qu’il entend ne laisser aucune richesse tomber en déshérence. De même s’il a toujours su en politique se maintenir à la crête de la vague, c’est au faîte de sa double culture qu’il s’est haussé et qu’il se tient.
Senghor s’évertuait à la réalisation du métissage culturel, de la symbiose entre les peuples et cultures pour prévenir le rejet réciproque, la méfiance et le mépris entre les nations. Senghor attribue au métissage une fonction unificatrice et préventive car elle « empêchera, par le dépassement dialectique des contraires ainsi posés par ce même métissage, l’uniformisation des comportements et, pis, des pensées sinon des sentiments qui expriment une rationalité univoque. » Par ce concept, il aspirait à réaliser l’harmonie, l’osmose entre les cultures et essayait d’empêcher la confrontation entre les peuples ou le choc des civilisations selon les termes de Huntington. La culture a, d’après lui, diverses fonctions, dont une fonction socioéconomique car elle devrait être en mesure de rationaliser la vie de l’homme et féconder et fructifier ses relations avec les autres cultures et peuples:
Une culture qui ne veut modifier ni le monde, ni les rapports extérieurs de l’homme, ni ses conditions de vie, est une culture de musée, qui craint l’air frais et l’action concrète parce qu’elle aime sa poussière et sa moisissure.
Senghor a forgé et lancé le concept de Civilisation de l’Universel pour mettre en œuvre et réaliser un dialogue enrichissant, fécond, mais libre et égalitaire entre les peuples et cultures, sans pour autant occulter ou ignorer les particularités culturelles, les différences identitaires de certains peuples. Au contraire, Senghor recommande fortement de les respecter et de leur prêter reconnaissance et considération car aucune culture ne devrait être la norme, le modèle d’autres. Cette conception senghorienne s’érige contre certaines tendances homogénéisantes de la mondialisation (sous le signe d’une domination de la culture occidentale). Senghor magnifie le dialogue interculturel dans le sens d’un échange égalitaire et d’une appropriation libre et volontaire des valeurs d’autrui. Pour prévenir l’anéantissement de sa culture, il plonge dans le monde occidental et puise dans ses sources. Dans un entretien, il rejette sans ambages toute idée de disparition pas seulement de sa propre culture, mais d’autres également. Ce qui, dit-il, pourrait entrainer un chaos culturel ou civilisationnel:
Avouez enfin que nous vous avons apporté la civilisation. Vous nous avez apporté votre civilisation. Laissez-nous y prendre ce qu’il y a de meilleur, de fécondant et souffrez que nous vous rendions le reste. Contact de deux civilisations, cela me semble être la définition la meilleure du problème. Du moins, c’est sous cet angle que nous voulons l’examiner «.
La Civilisation de l’Universel est à proprement parler l’expression d’une humanité nouvelle qui résulte du métissage culturel et du triomphe des différences ethniques et culturelles. Senghor présente la Civilisation de l’Universel comme l’expression de la diversité dans l’unité, c’est-à-dire que tous les peuples, toutes les nations prennent part à un échange transnational, universel et interculturel avec leurs idées et valeurs linguistiques et culturelles. La Civilisation de l’Universel ne s’entend pas comme la négation du particulier, mais au contraire comme son renforcement, son approfondissement. Il considère ainsi la négritude et ses valeurs comme la contribution des peuples noirs au dialogue entre les cultures:
Pour nous, notre souci, depuis les années 1932–1934, notre unique souci a été de l’assumer, cette négritude, en la vivant, et, l’ayant vécue, d’en approfondir le sens. Pour la présenter, au monde, comme une pierre d’angle dans l’édification de la Civilisation de l’Universel, qui sera l’œuvre commune de toutes les races, de toutes les civilisations différentes – ou ne sera pas. (C’est Senghor qui souligne)
Le poète du Royaume d’enfance ne considère pas les différences ethniques et culturelles entre les peuples comme un aspect négatif, mais comme un avantage certain, car elles contribuent à un enrichissement mutuel des peuples. Il souligne que les cultures devraient surmonter et transcender leurs différences, s’enrichir mutuellement pour converger vers l’Universel: » s’enrichir de nos différences pour converger vers l’Universel. « Le concept senghorien prend en compte la spécificité, l’altérité, les particularités de chaque peuple parce que la diversité culturelle est le substrat de l’Universel. La Civilisation de l’Universel assimile les valeurs de l’humanisme et les intègre dans une réconciliation des contraires, dans un accord conciliant et s’avère par conséquent comme l’œuvre commune de tous les continents, de tous les peuples, de toutes les nations, cultures et civilisations:
En cette seconde moitié du XXe siècle donc, où s’élabore, avec nous et malgré nous à la fois, la civilisation de l’universel par totalisation et socialisation de la planète et comme œuvre commune de tous les continents, de toutes les races, de toutes les nations, l’universitas ne saurait être d’abord, que la compréhension de tous les apports de chaque continent, de chaque race, voire de chaque nation.
Conclusion
L’œuvre de Léopold Sédar Senghor repose en grande partie sur les trois concepts majeurs – Négritude, Francophonie et Dialogue des cultures – auxquels il a consacré toute sa vie et qui ont forgé sa réputation internationale. Après la défense de la négritude et la proclamation et glorification des valeurs culturelles du monde noir, Senghor s’est tourné vers le concept de Francophonie pour amorcer une véritable coopération politique, culturelle et socioéconomique entre les différents pays francophones et l’ancienne puissance coloniale. Il convient cependant de préciser qu’il n’existe pas de contradictions entre ces deux concepts car aboutissant tous les deux à un dialogue, un échange fructueux et enrichissant entre les peuples et nations à travers leurs idées et valeurs culturelles. La volonté de Senghor de s’approprier les valeurs et vertus d’autres peuples et cultures est nettement perceptible dans son œuvre poétique et théorique. En effet, Senghor se révèle être lui-même un mélange de différentes influences culturelles qui a sous ce rapport puisé dans les idées et idéologies d’autres littératures et cultures: » j’ai pris mon bien partout où je l’ai trouvé. «
Bibliographie
Gnalega, René (2002): Senghor et la Francophonie. In: Ethiopiques nº 69. Hommage à Léopold Sédar Senghor, 2eme semestre, pp. 179–189.
Guibert, Armand (1969): Léopold Sédar Senghor. Collection Poètes d’aujourd’hui. Paris, Seghers.
KINDO, Aissatou Soumana (2002): Senghor, de la négritude à la francophonie. Hommage à Léopold Sédar Senghor. In Ethiopiques n°69, 2ème semestre.
Ndiaye, Babacar (2002): Interculturalité et paix: La carte civilisationnelle hungtonienne face au modèle Senghorien de la francophonie. In: Ethiopiques n° 71, 2eme semestre.
Porra, Veronique und Georg Glasze (Hrsg.): Die Frankophonie als globaler Kulturraum und internationaler geopolitischer Akteur. Projekt des Zentrums für interkulturelle Studien der Johannes Gutenberg Universität von Mainz. http://www.zis.uni-mainz.de/Dateien/ZIS-Poster_Frankophonie.pdf, konsultiert am 04.06.2013 um 3:15.
SENGHOR, Léopold Sédar (1964): Liberté 1: Négritude et humanisme. Paris, Seuil.
SENGHOR: Liberté 3 (1977): Négritude et Civilisation de l’Universel. Paris, Seuil.
SENGHOR: Liberté 5 (1993): « Le dialogue des cultures ». Paris, Editions du Seuil.
SENGHOR: Œuvre poétique (1990), Paris, Editions du Seuil.
Senghor, Léopold Sédar (1988): Ce que je crois. Paris, Editions Grasset & Fasquelle.
Auteur: Dr. Ibrahima Diop
Professeur d’allemand
Docteur en littérature allemande et comparée de l’université de Bochum (Allemagne)
Chargé de cours à l’université de Thiès.
-
Association de recherche
- arsc
- bigsas
- ciéf
- Oudjat
- sfps
- sielec Base de données littératures francophones
- francofil
- La décolonisation des savoirs
- limag
- litaf Librairies/Editions
- Oudjat Pôles de recherche
- labos univ-metz
- msha
- u-cergy Revues
- africultures
- ingentaconnect
- motspluriels
- JUSTIN BISANSWA REND HOMMAGE �...
- Justin Bisanswa rend hommage �...
- COLLOQUE INTERNATIONAL EN HOMM...
- PRISCA OTOUMA (OBSOLESCENCE, �...
- SAMI TCHAK-LES VOIES D’U...
- SÉBASTIEN HEINIGER (DÉCOLONI...
- SAMI TCHAK : LES VOIES D’...
- APPEL À COMMUNICATIONS
- UNIVERSITÉ OMAR BONGO (LIBREV...
- COLLOQUE INTERNATIONAL EN HOMM...
- UNIVERSITÉ DE LORRAINE: JOURN...
- REVUE ÉTHIOPIQUES: APPEL À C...