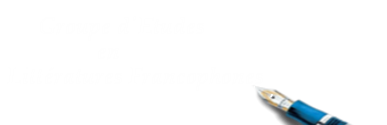QUAND LES MURS TOMBENT
D’Edouard Glissant et de Patrick Chamoiseau. Paris, Editions Galaade-Institut du Tout-Monde, 2007, 26 pages. ISBN: 978-2-35176-047-5.
L’identité
« Une des richesses les plus fragiles de l’identité, personnelle ou collective, et les plus précieuses aussi, est que, d’évidence, elle se développe et se renforce de manière continue – nulle part on ne rencontre de fixité identitaire -, mais aussi qu’elle ne saurait s’établir ni se rassurer à partir de règles, d’édits, de lois qui en fonderaient d’autorité la nature ou qui garantiraient par force la pérennité de celle-ci. Le principe d’identité se réalise ou se déréalise parfois dans des phases de régression (perte du sentiment de soi) ou de pathologie (exaspération d’un sentiment collectif de supériorité) dont les diverses « guérisons » ne relèveraient pas, elles non plus, de décisions préparées et arrêtées, puis mécaniquement appliquées » (page 1).
L’Etat-nation
« En Occident et d’abord en Europe, les collectivités se sont constituées en nations, dont la double fonction fut d’exalter ce qu’on appelait les valeurs de la communauté, de les défendre contre toute agression extérieure et, si possible, de les exporter dans le monde. La nation devient alors un Etat-nation, dont le modèle peu à peu s’impose et définit la nature fondamentale des rapports entre peuples dans le monde moderne. La communauté qui vit en Etat-nation sait pourquoi elle le fait, sans jamais pouvoir le figurer par postulats et théorèmes; c’est la raison pour laquelle elle exprime cela par symboles (les fameuses valeurs), auxquels elle prétend attribuer une dimension d’ »universel ». Une telle organisation est au principe des conquêtes coloniales, la nation colonisatrice impose ses valeurs et se réclame d’une identité préservée de toute atteinte extérieure et que nous appellerons une identité racine unique. Même si toute colonisation est d’abord d’exploitation économique, aucune ne peut se passer de cette survalorisation identitaire qui justifie l’exploitation. « L’identite-racine unique » a donc toujours besoin de se rassurer en se définissant, ou du moins en essayant de le faire. Mais ce modèle s’est aussi trouvé sinon à l’origine, du moins à la mise en oeuvre des luttes anticolonialistes; c’est dans la revendication d’une identité nationale, héritée de l’exemple du colonisateur, que les communautés dominées ont trouvé la force de résister. Le schème de l’Etat-nation s’est ainsi multiplié dans le monde. Il n’en est résulté que des désastres » (pages 2-3).
L’appel
« Les murs menacent tout le monde, de l’un et l’autre côté de leur obscurité. Ils achèvent de tarir ce qui s’est desséché sur ce versant du dénuement, ils achèvent d’aigrir ce qui s’est angoissé sur l’autre versant, de l’abondance. La relation à l’autre (à tout l’autre, dans ses présences animales, végétales, et culturelles, et par conséquent humaines) nous indique la part la plus haute, la plus honorable, la plus enrichissante de nous-mêmes. Que tombent les murs. / Nous demandons que toutes les forces humaines, d’Afrique, d’Asie, d’Europe, des Amériques, que tous les peuples sans Etats, tous les « républicains », tous les tenants des « droits de l’homme », les habitants des plus petits pays, les insulaires et les errants des archipels autant que les traceurs de continents, que tous les artistes, les hommes et les femmes de connaissance et d’enseignement, et toute autorité citoyenne ou de bonne volonté, ceux qui façonnent et qui créent, élèvent, par toutes les formes possibles, une protestation contre ce mur-ministère qui tente de nous accommoder au pire, de nous habituer peu à peu à l’insupportable, de nous mener à fréquenter, en silence et jusqu’au risque de la complicité, l’inadmissible. / Tout le contraire de la beauté » » (pages 25-26).
Texte de circonstance, celui d’Edouard Glissant et de Patrick Chamoiseau n’en est pas moins intemporel, aussi bien du point de vue de ses thèmes majeurs (la relation, la domination, l’identité) que dans ses aspirations ou utopies (le tout-monde, la paix universelle, la fin des ségrégations). Les deux auteurs entrevoient en effet une « mondialisation » de l’imaginaire, résumée dans ce passage de leur pétition:
« Les arts, les littératures, les musiques et les chants fraternisent par des voies d’imaginaires qui ne connaisent plus rien aux seules géographies nationales ou aux langues orgueilleuses dans leur à-part. … Le chatoiement de ces lieux ouvre à l’insurrection infinie des imaginaires libres: à cette mondialité » (pages 16-17).
-
Association de recherche
- arsc
- bigsas
- ciéf
- Oudjat
- sfps
- sielec Base de données littératures francophones
- francofil
- La décolonisation des savoirs
- limag
- litaf Librairies/Editions
- Oudjat Pôles de recherche
- labos univ-metz
- msha
- u-cergy Revues
- africultures
- ingentaconnect
- motspluriels
- JUSTIN BISANSWA REND HOMMAGE �...
- Justin Bisanswa rend hommage �...
- COLLOQUE INTERNATIONAL EN HOMM...
- PRISCA OTOUMA (OBSOLESCENCE, �...
- SAMI TCHAK-LES VOIES D’U...
- SÉBASTIEN HEINIGER (DÉCOLONI...
- SAMI TCHAK : LES VOIES D’...
- APPEL À COMMUNICATIONS
- UNIVERSITÉ OMAR BONGO (LIBREV...
- COLLOQUE INTERNATIONAL EN HOMM...
- UNIVERSITÉ DE LORRAINE: JOURN...
- REVUE ÉTHIOPIQUES: APPEL À C...