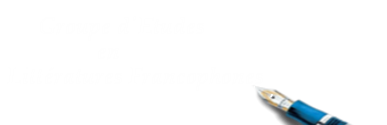PRISKA DEGRAS:
L’Obsession du Nom dans le roman des Amériques. Paris, Karthala, Collection « Lettres du Sud », dirigée par Henry Tourneux, 2011, 264 pages.
ISBN: 978-2-8111-0484-9
Édouard Glissant, Simone Schwarz-Bart, Saint-John Perse, Toni Morrison, Ralph Ellison, Vidiadkhar Sarajprasad Naipaul, Aimé Césaire, Gabriel Garcia Marquez et Xavier Orville sont les auteurs chez qui Priska Degras analyse « l’obsession du Nom »:
»De Ralph Ellison à Toni Morisson, de Saint-John Perse à V. S. Naipaul, de Simone Schwarz-Bart à Edouard Glissant, l’envahissante présence de la question du Nom manifeste le désir constant – et diversement accompli – d’une recréation romanesque des passés enfouis ou travestis, d’une réécriture poétique de l’Histoire » (11).
Si dans l’espace de la Caraïbe l’origine est souvent liée à une vacuité, la littérature, par des « détours » (39), tente de combler ce manque. Priska Degras cite, pour illustrer cette propension de l’écriture, les paroles de Marie Celat dans Mahagony (1987) d’Edouard Glissant:
« Odono est remonté avec cette herbe dans ses cheveux défunts, l’herbe du fonds marin qui l’a englouti pour toujours. C’est de lui que je veux parler parce que son nom vous agace. On a fait des livres sur son nom, vous croyez que cet ami a écrit tout au long sur mon histoire, mais c’était pour expliquer ce nom-là. Je comprends à quel point il veut déballer tout cela, c’est pour expliquer le nom? Voilà pourquoi nous le gardons à écrire. Pour tenter d’expliquer les noms. Moi, je récolte dans les herves qui n’arrêtent pas de mourir » (E. Glissant: Mahagony. paris, Seuil, 1987, page 173).
Si le nom renvoie à l’origine, il renvoie aussi, dans les Amériques, à une conscience fragmentaire, car le passé n’est pas parfaitement lisible:
« Je crois que la hantise du passé … est un des référents essentiels de la production littéraire dans les Amériques … Le romancier américain, quelle que soit la zone à laquelle il appartient, n’est pas du tout à la recherche d’un temps perdu mais se trouve, se débat, dans un temps éperdu. Et, de Faulkner à Carpentier, on est en présence de sortes de fragments de durée qui sont engloutis dans des amoncellements ou des vertiges » (E. Glissant: Le Discours antillais. Paris, Seuil, 1981, page 15).
Priska Degras note à ce propos:
« Les traces manifestes ou voilées, criantes ou sourdes de ce passé malheureux marquent inévitablement l’écriture romanesque en faisant peser sur elle la charge, toujours lourde, d’une Histoire qui, pour de nombreux écrivains caraïbes, reste encore à écrire. Il semble que, pour nombre d’entre eux, ce passé douloureux et longtemps occulté figure l’absence et le vide que l’écriture, impuissante à les combler, au moins signifie, bien qu’elle ne rattrape jamais , selon la formule de Glissant. Bien que l’écriture soit impuissante parfois à véritablement circonscrire ce manque obscur, il apparaît pourtant que le travail romanesque de nombre d’écrivains des Amériques s’obstine à manifester ce manque. Manifester le manque, c’est aussi affirmer la volonté d’en retracer les origines et de tenter, ainsi, de dépasser le réseau d’impossibilités qui en sont ses inévitables conséquences » (60-61)
La tradition, l’héritage, la transmission en deviennent des termes problématiques. Ce que Saint-John Perse formule ainsi:
« Nous n’avons point tenure de bief ni terre de bienfonds / Nous n’avons point connu le legs ni ne saurions léguer » (Saint-John Perse: Oeuvres complètes. paris, Gallimard, Bibliothèqe de la Pléiade, 1998, page 396).
Toni Morrison envisage la question sous l’angle d’une volonté, celle de bâtir, de « mettre de l’ordre dans le désordre » (cité à la page 88). Tout comme Aimé Césaire fera de l’Afrique l’espace de ses rêves de retrouvailles avec une origine qu’il n’a cessé de magnifier.
Passé et présent, dans l’espace des Amériques, sont troubles du fait des traces d’histoires et de géographies constitutives ici de l’identitté. Aussi, au-delà de « l’innommable de l’Histoire » (199) , note Priska Degras, seule la « pensée archipélique » (Cf. pages 199-200) paraît adéquate à la formulation des phénomènes linguistiques, culturels et sociaux. Mais cette pensée « de la trace, pensée féconde et libératrice, ne peut être séparée de celle de l’errance » (Priska Degras, page 202).
Le vide et l’errance auxquels renvoient les Amériques, sont toutefois propices à la création sans limites:
« C’est de l’immensité de ces espaces américains que peut alors se proclamer cet apparent et double paradoxe: c’est du vertige du vide que naît l’abondance de sens, c’est du désir neuf de proférer la parole archaïque et secrète que procède la plus radicale modernité. C’est enfin de l’absence multiple et signifiante du Nom que peut jaillir et se déployer, dans la plus grande liberté, le roman des Amériques, inscrit dans une Histoire impossible et pourtant ravivée, révolue et toujours à venir, indicible et cependant nommée » (Priska Degras, page 247).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
« Métaphore de l’Histoire, l’obsédante question du Nom s’inscrit profondément dans les textes de la loi coloniale mais aussi dans de larges pans de la création littéraire des Amériques. La réalité ancienne de l’attribution d’un patronyme aux esclaves accédant à la liberté et sa recréation littéraire forment une double constellation signifiante permettant de mesurer le poids immense de la fonction symbolique de cette nouvelle nomination. / L’envahissante présence de la question du Nom dans le roman des Amériques manifeste le désir constant d’une réécriture poétique de l’Histoire. Les avatars romanesques du patronyme portent au jour la douleur ancienne et continuée des passés enfouis ou travestis; ils rassemblent les fragments épars et obscurs d’une diffuse mémoire collective longtemps écartelée entre deux impossibles: celui du souvenir et celui de l’oubli de l’esclavage. / L’obsession du Nom témoigne de la persistance du manque et de la blessure de l’Histoire mais révèle également la volonté d’en dépasser l’innommable. Le Nom n’est plus alors l’espace emblématique d’une abscence douloureuse mais le territoire neuf d’une liberté sans limite: celle de l’imaginaire » (Quatrième de couverture).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
D’origine martiniquaise, Priska Degras est née et vit à Paris. Après avoir enseigné aux Etats-Unis (à Sarah Lawrence, New York et Louisiana State University, Baton Rouge), elle est à présent maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille III et chercheur associé à Paris-IV Sorbonne (Quatrième de couverture).
Contact: priska.degras@wanadoo.fr
-
Association de recherche
- arsc
- bigsas
- ciéf
- Oudjat
- sfps
- sielec Base de données littératures francophones
- francofil
- La décolonisation des savoirs
- limag
- litaf Librairies/Editions
- Oudjat Pôles de recherche
- labos univ-metz
- msha
- u-cergy Revues
- africultures
- ingentaconnect
- motspluriels
- JUSTIN BISANSWA REND HOMMAGE �...
- Justin Bisanswa rend hommage �...
- COLLOQUE INTERNATIONAL EN HOMM...
- PRISCA OTOUMA (OBSOLESCENCE, �...
- SAMI TCHAK-LES VOIES D’U...
- SÉBASTIEN HEINIGER (DÉCOLONI...
- SAMI TCHAK : LES VOIES D’...
- APPEL À COMMUNICATIONS
- UNIVERSITÉ OMAR BONGO (LIBREV...
- COLLOQUE INTERNATIONAL EN HOMM...
- UNIVERSITÉ DE LORRAINE: JOURN...
- REVUE ÉTHIOPIQUES: APPEL À C...